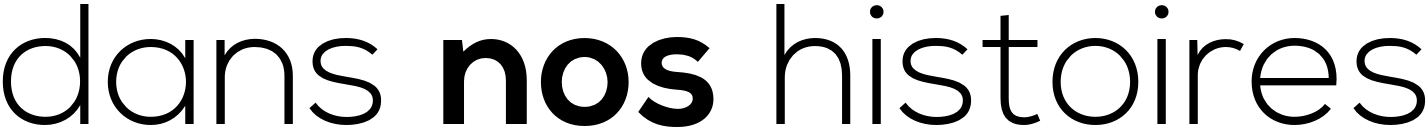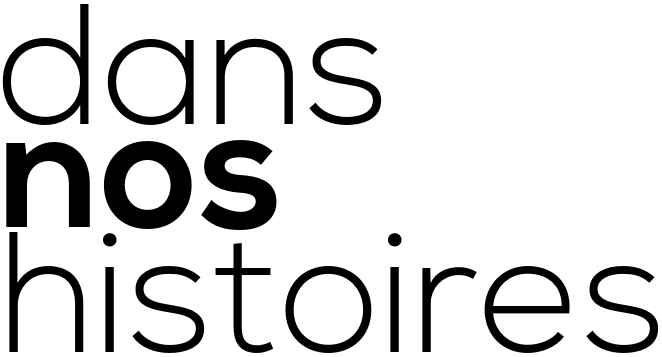Mulholland Drive
la clef des songes
Pierre Tevanian
Le livre est proposé ici au format lyber (accès libre intégral). Vous pouvez commander la version papier en cliquant ici.
« Le rêve est une seconde vie. »
Gérard de Nerval, Aurélia
« une clef, ça ne te dit rien ? »
Au sens propre comme au figuré, Mulholland Drive est un film à clef. Il y a d’abord, dès le commencement, cette mystérieuse clef bleue trouvée par les deux héroïnes au fond d’un sac. Plus profondément, il y a le fait que cette clef elle-même doit être pensée, interprétée, déchiffrée par les spectateurs et spectatrices du film pour résoudre un mystère – et même plusieurs. Le mystère d’abord de l’identité perdue d’une des deux héroïnes devenue amnésique, pour qui la clef bleue est, avec une liasse de billets (trouvée au fond du même sac) et le double souvenir d’un nom de lieu (Mulholland Drive) et d’un nom de personne (Diane Selwyn), la seule trace à partir de laquelle une histoire peut être reconstituée. Il y a ensuite ce mystérieux contrat de meurtre qui semble planer sur elle, et dont en ouverture du film elle a provisoirement réchappé. Enfin il y a le mystère que construit le film lui-même : un agencement de séquences en elles-mêmes intelligibles mais sans rapport manifeste entre elles, ni en termes d’enchaînements logiques ni d’un point de vue affectif, puisque les registres les plus hétérogènes se juxtaposent ou se mélangent. Le film a commencé comme un thriller mais il divague très vite dans tous les sens, épouvante, comédie loufoque, mélodrame d’amour : aucun fil évident ne permet de relier l’enquête ludique que mènent les deux héroïnes Betty et Rita, leurs rapports comiques avec une sympathique gardienne d’immeuble (Coco Lenoix) ou avec une inquiétante voisine (Louise Bonner), le cauchemar terrifiant d’un jeune client du café Winkie’s, les déboires tragicomiques d’un cinéaste (Adam Kesher) avec son directeur de casting puis son nettoyeur de piscine, les revers d’un tueur à gages maladroit, ou encore la présence fantomatique d’une espèce de Mafia et l’inquiétante étrangeté d’un cowboy qui semble en être le messager, et enfin l’atroce découverte d’un cadavre dans un appartement de Sierra Bonita, jusqu’à ce paroxysme du mystère que constitue le spectacle donné dans un théâtre nommé Silencio, à mi-chemin entre magie et farce macabre.
Si chaque segment nous passionne en lui-même, sous diverses modalités (l’angoisse, la terreur, le rire), une autre strate d’émotions et de pensée nous rend doublement captifs : quelque chose comme un supplément d’inquiétude, et donc de questionnement, est produit par cette absence même de connexions entre les différents fragments qui défilent. Il y a, pour le redire avec ce mot, une clef qui manque et qu’instinctivement nous recherchons : quel lien regroupe ces personnages qui semblent ne pas se connaître, ces intrigues étrangères les unes aux autres et pourtant enchevêtrées, et ces gammes d’affects tellement dissonantes ?
Au-delà même de cet enchaînement inexpliqué d’intrigues disparates, le paradoxe, la contradiction, l’inquiétante étrangeté se manifestent également à l’intérieur de chaque scène : les séquences les plus nombreuses, celles qui impliquent les deux héroïnes Betty et Rita, ont ceci de déroutant qu’elles sont vécues ensemble mais sous une modalité absolument opposée. Une rencontre inopinée dans un appartement, un coup de téléphone à la police, la visite d’une voisine, tout est vécu par Betty avec une légèreté, une insouciance, un optimisme, une gaieté imperturbable et presque excessive, et par Rita au contraire dans une gravité et une terreur tout aussi étonnante. D’où vient cette énergie vitale surabondante qui porte Betty, et de quels abîmes revient Rita pour être à ce point défaite, disloquée, diminuée ? Quels démons ou quelle malédiction fuit-elle pour être à ce point apeurée ? Telles sont les questions que nous nous posons confusément, et qui nous rendent rapidement attentifs au moindre détail, avides de clefs explicatives.
La recherche d’une clef s’impose plus encore après deux heures de film lorsque, dans un récit jusque-là énigmatique mais ne sortant presque jamais du strict réalisme, viennent tout à coup, inexplicablement une fois de plus, se multiplier des événements surnaturels : tout d’abord l’apparition magique d’une boite bleue dans le sac de Rita, puis la disparition tout aussi magique de Betty, puis de Rita, puis de la boîte elle-même, puis la réapparition de Tante Ruth dans un appartement qu’elle était censée avoir laissé à sa nièce Betty. Après quoi le mystère prolifère plus encore : nous voyons Betty se réveiller dans un nouvel appartement, sous une autre identité, celle de Diane Selwyn, la morte, et nous retrouvons Rita, qui se nomme désormais Camilla. Diane est aussi ténébreuse que Betty était rayonnante, et Camilla aussi sûre d’elle que Rita était apeurée. Le cinéaste Adam Kesher revient lui aussi métamorphosé : aussi triomphant qu’il était piteux jusque-là, et surtout connecté désormais aux deux héroïnes (il les dirige toutes les deux dans un film, et il épouse Camilla), ainsi qu’au personnage de Coco, qui est désormais sa mère. C’est en fait l’ensemble des personnages que nous voyons revenir sous de nouvelles identités, dans de nouveaux rôles, tous reliés désormais avec le personnage de Diane. Le cowboy et le chef de la Mafia deviennent ses convives lors d’une fête sinistre à Mulholland Drive. Quant au tueur, c’est elle-même qui le convoque et le paye… pour faire assassiner Camilla. Toute cette fin de film, jusqu’à son dénouement horrible, appelle une explication qui manque cruellement : une clef.
Si tout le film fait signe vers une clef manquante, ce n’est pourtant pas cette clef, ni même son absence, qui fait sa force. La prolifération finale de changements d’identité, d’inversions de situations et de connexions nouvelles entre les personnages nous laisse dans un état de tournis et d’incompréhension, mais elle n’empêche pas d’être touché, bouleversé même, par ces fragments que nous voyons défiler trop vite. Si nous ne comprenons pas les connexions entre ces fragments, et moins encore la logique des déplacements et des retournements de la dernière demi-heure, nous en comprenons assez en tout cas : nous saisissons des morceaux d’histoires qui sont en eux-mêmes intelligibles et émouvants – ceux de la fin du film en particulier, qui nous montrent, avec une immense empathie, avec une immense délicatesse, l’effondrement, la détresse, la souffrance d’un être (Diane) que nous avions pendant deux heures connu (sous le nom de Betty) comme le personnage fort, joyeux, solaire, d’une histoire tout au plus étrange, tordue et vaguement inquiétante.
Ce n’est donc pas la clef explicative elle-même qui, comme dans certains films à suspense ou à coup de théâtre, donne au film tout son intérêt. Ce n’est pas non plus la recherche de cette clef explicative qui le rend jouissif ou captivant. C’est plutôt l’inverse : c’est le caractère troublant, inquiétant puis poignant du peu que nous comprenons qui génère le besoin impérieux, presque moral, d’en savoir plus, de comprendre vraiment de quoi il a retourné. C’est parce que le peu qu’on a saisi a suffi à nous faire aimer les deux héroïnes que nous devenons à notre tour, à l’issue du film, des enquêteurs : nous devons comprendre de quoi elles sont mortes, comme si elles étaient nos propres sœurs.
Cela suffit, pour ce qui me concerne, à justifier la « violence herméneutique » qu’une certaine cinéphilie pourra reprocher aux pages qui vont suivre. J’ai aimé un film, j’ai aimé ses personnages et cet amour me donne l’envie et le droit d’enquêter, déduire, interpréter, proposer une explication et essayer de convaincre. Je veux savoir ce qui est arrivé vraiment à ces femmes que j’aime – quelque chose sans doute qui m’est un peu arrivé à moi aussi, comme souvent quand un film nous touche, même si ce n’est qu’une sensation confuse. Que s’est-il passé ? Que raconte vraiment ce film ? Qui est qui ? Quelles sont les vraies identités, quelles sont les fausses ? Qu’est-ce qui s’est passé avant, qu’est-ce qui s’est passé après ? Et enfin, nous y arrivons : qu’est-ce qui est réel, qu’est-ce qui ne l’est pas ?
Car bien entendu une interprétation, très classique, s’est imposée rapidement : il y a dans Mulholland Drive une partie réelle et une partie rêvée – ou plutôt il y a d’abord un rêve qui dure deux heures, après quoi l’héroïne se réveille et nous découvrons sa dure réalité. Cette interprétation dominante a très vite fédéré contre elle les gardiens d’une cinéphilie distinguée pour qui la recherche d’un sens est en soi une faute de goût, un dévoiement de la fonction critique, un outrage à la dimension esthétique, à la « matière filmique » et à l’irréductible polysémie de l’œuvre avec un grand o. Je revendique a contrario le droit de n’importe quel spectateur et n’importe quelle spectatrice à parler des films comme il ou elle l’entend : un droit à trouver dans un film ce que bon nous semble y compris une clef, à parler de matière si on veut parler de matière et de forme si on veut parler de forme, et à ne pas le faire si on préfère parler simplement de ce que ça raconte. Un droit en somme à prendre le film par le bout qu’on veut, que ce soit la mise en scène, le scénario, la musique, le montage ou simplement les acteurs, les personnages, l’histoire et la morale de l’histoire. Il se trouve que, pour ma part, comme beaucoup de spectateurs et spectatrices à la sortie des cinémas, la question qui me préoccupe – au départ en tout cas – est cette question plus qu’aucune autre : quel est le propos, le sens caché, le fin mot de l’histoire ? Qui est le vrai coupable, le vrai méchant ? Betty est-elle vraiment un ange, et Rita une proie ? Diane est-elle vraiment « la victime » et Camilla « la garce » ? Adam est-il un sale con ou juste un petit malin ? Que je parle peu de l’immense et magnifique travail formel sur la lumière, le cadre, le son, la musique, que je parle peu du génie des actrices et des acteurs, ne me paraît pas grave : de tout cela je ne sais pas bien parler mais c’est bien tout cela qui a rendu possible mon amour du film et de ses personnages – et donc tout ce qu’ensuite j’ai voulu élucider, penser, écrire. Et il en va de même dans les derniers chapitres de ce livre quand un autre film est évoqué, un film étonnement proche de Mulholland Drive intitulé Céline et Julie vont en bateau. Du génie de Jacques Rivette ou de Juliet Berto je parle aussi peu que du génie de David Lynch ou Naomi Watts : de ce génie je me contente de prendre acte et j’essaye ensuite – comme au fond tout spectateur ou toute spectatrice qui aime un film – de le laisser inspirer mes pensées.
« cet endroit de rêve »
Il sera donc question d’un rêve et d’un réveil. Cette interprétation est sans doute la moins originale, mais c’est elle que j’ai faite mienne. Je ne l’ai pas inventée, et je n’en ai même pas eu l’intuition quand je suis sorti, perdu mais ému, de ma première vision du film. Mais lorsqu’elle m’a été exposée, je l’ai prise au sérieux et elle s’est imposée à moi dès la seconde vision. Elle a dissipé de larges pans de mystère, sans rien retirer – au contraire – à la force de l’ensemble, et je l’ai faite mienne pour la simple raison qu’elle est cohérente, qu’elle résonne avec d’innombrables éléments aussi bien dans le scénario que dans la mise en scène, et qu’elle s’avère féconde. Elle m’apporte une réponse sur la mort des deux héroïnes, et quelques autres pensées précieuses sur des sujets importants : je vois dans Mulholland Drive une réflexion – ou plutôt une rêverie – sur l’amour, la haine et le deuil, je vois aussi une élégie, un monument érigé en hommage aux victimes d’Hollywood, et une méditation sur le pouvoir terrible des images et leur influence sur la vie. Je vois ce film aussi – des séquences violentes comme celle de l’audition de Betty m’y obligent [1] – comme un pamphlet violent contre l’ordre sexiste, et plus largement, plus profondément, contre « l’usine à rêves » qu’est Hollywood, et contre ses effets destructeurs sur la subjectivité.
Il y a donc un long rêve de près de deux heures, puis un réveil et un enchaînement précipité de gestes, d’hallucinations et de souvenirs qui dure une vingtaine de minutes et qui s’achève avec le suicide de la rêveuse Diane Selwyn. Le film signale le commencement d’un rêve dès la deuxième séquence, puisqu’on suit en caméra subjective l’engloutissement d’un visage dans un oreiller rose. Le retour à la réalité est lui aussi marqué nettement, par le passage du cowboy et ses mots on ne peut plus explicites : « Debout ma belle, il est temps de te réveiller » – des mots immédiatement suivis par le réveil de Naomi Watts dans une autre maison (à Sierra Bonita et non plus Havenhurst), une autre identité (Diane Selwyn et non plus Betty Elms) et d’autres états de corps (non plus joyeux mais douloureux).
Puis en revoyant le film plusieurs fois, nous découvrons une multitude d’autres indications qui, tout au long de la première partie, jettent la suspicion sur la réalité de ce qui est en train de se passer, et laissent pressentir un envers bien plus dur, tragique, atroce que l’idylle naissante entre Betty et Rita, leur enquête ludique et les premiers pas réussis de Betty dans la grande famille hollywoodienne. Peu de temps après l’accident de voiture qui sauve la vie de Rita, par exemple, le personnage du tueur, hilare, fait allusion à un accident de voiture qu’il qualifie d’« irréel », puis réapparaît un peu plus tard aux abords du Winkie’s, à la recherche d’« une brune » qui évoque immanquablement Camilla – celle donc qu’il a bel et bien tuée dans la réalité mais qui lui échappe provisoirement dans ce monde parallèle. Betty de son côté s’émerveille devant le spectacle des collines hollywoodiennes en s’exclamant : « Je ne peux pas le croire ! » et qualifie ensuite le luxueux appartement de sa tante d’« endroit de rêve ». Enfin, Adam Kesher tente de dédramatiser ses déboires avec la Mafia en lâchant que « tout ça, c’est du flan ». Chacune de ces sentences s’avèrera, après le réveil de Diane, rigoureusement exacte.
Au-delà de ces paroles, il y a aussi l’aspect excessif, surjoué, qu’ont toutes les expressions de gaité et de bonté durant les deux premières heures. L’optimisme exagéré de Betty mais aussi le dévouement et l’amabilité de la gardienne Coco, l’accueil chaleureux de Wally Brown lors de l’audition, son enthousiasme après la prestation de Betty, et enfin les encouragements affectueux que lui adressent ses deux compagnons de voyage, à l’aéroport : tout cela sonne faux, forcé, factice, et diffuse sur l’ensemble de l’intrigue un halo d’irréalité. C’est en somme le corps même des acteurs qui nous suggère que tout cela est trop beau pour être vrai.
La question qui, dès lors, se pose immanquablement, c’est pourquoi Diane rêve ce qu’elle rêve : quelle est la logique de son travail onirique, c’est-à-dire des transformations qu’elle fait subir à la réalité, des déplacements étranges qu’elle opère sur les mots, les lieux, les identités ? Pourquoi, notamment, Diane a-t-elle préféré dans son rêve habiter un appartement luxueux (à Havenhurst) plutôt qu’un modeste deux-pièces (à Sierra Bonita), tout en empruntant l’identité d’une serveuse (Betty) ? Pourquoi a-t-elle transformé un convive anonyme et effacé en caïd de la Mafia, et la mère d’un grand cinéaste en gardienne d’immeuble ? Pourquoi a-t-elle débaptisé et diminué l’être aimé, et abandonné le nom de cet être aimé (« Camilla Rhodes ») à une blonde inconnue qu’elle n’a croisée qu’une seule fois ? Notre enquête peut commencer.
« un accident à Mulholland drive »
Pour commencer, que nous apprend le film, à la première vision ? Il s’ouvre sur un pré-générique montrant une dizaine de couples en train de danser sur une musique rétro. Nous voyons subrepticement apparaître en surimpression, entouré d’un couple de vieillards jovial, le visage radieux de l’actrice Naomi Watts, qui endossera dans le film deux identités : Betty Elms, puis Diane Selwyn. Le plan suivant marque une première rupture : la musique s’arrête pour ne plus laisser entendre qu’une respiration suffocante, et nous suivons en caméra subjective un corps qui se rapproche d’un coussin rose et s’y enfonce. C’est alors, après un fondu au noir, que le générique commence : une voiture s’engage en pleine nuit sur Sunset Boulevard. L’endormissement a été figuré à l’écran, le rêve peut commencer.
Aux abords de Mulholland Drive, une femme brune, jouée par Laura Elena Harring, échappe miraculeusement à une tentative d’assassinat grâce à un accident de voiture qui tue sur le coup ses deux agresseurs. Seule rescapée, elle se dégage péniblement de la carcasse en feu, et redescend en titubant vers les lumières de la ville. Profitant de l’entrebâillement d’une porte, elle s’introduit discrètement dans la riche demeure d’une vieille dame qui part en voyage. C’est là que, le lendemain, elle fait la rencontre de Betty, qui vient habiter la maison inoccupée de sa tante Ruth. Tout d’abord surprise, Betty réalise assez vite que l’intruse a besoin d’aide : à peine remise de son accident, elle a perdu la mémoire et ignore jusqu’à son propre nom. Elle ne trouve dans son sac qu’une clef bleue accompagnée de plusieurs liasses de billets, et ne se souvient que d’une adresse : « Mulholland Drive, c’est là que j’allais ». Betty se décide aussitôt à aider l’inconnue, qui s’est choisi pour identité provisoire le prénom de Rita Hayworth, aperçu sur une affiche du film Gilda dans l’appartement de Tante Ruth.
En même temps que progresse cette première intrigue, nous sommes témoins d’une longue série d’événements parfois comiques, souvent inquiétants, toujours étranges. Un jeune homme convoque un ami dans un bar, le Winkie’s, pour lui faire le récit d’un cauchemar, il aperçoit en sortant l’espèce de tête de Méduse (visage hideux, cheveux en bataille) dont il avait rêvé et s’écroule, pétrifié. Un tueur à gages particulièrement maladroit abat trois personnes pour se procurer un agenda supposé contenir « toute l’histoire du monde ». Des coups de téléphone et des rendez-vous secrets se tiennent à propos d’une mystérieuse « fille » qui a disparu et que tout le monde recherche – en particulier le tueur maladroit. On apprend que cette fille est brune, et l’on suppose donc qu’il s’agit de Rita, mais rien n’est certain. Enfin, un réalisateur de films nommé Adam Kesher vit une véritable descente aux enfers : la Mafia lui impose sa propre candidate, une blonde nommée Camilla Rhodes, pour le premier rôle de son film, puis fait interrompre le tournage lorsqu’il tente de résister. Il découvre que ses comptes en banque sont bloqués, puis se fait humilier par un messager placide habillé en cowboy, qui se fait d’ailleurs appeler « le cowboy » – et comme si tout cela ne suffisait pas, il surprend sa femme au lit avec « Gene Clean », son nettoyeur de piscine.
À l’opposé de la détresse de Rita et des humiliations répétées d’Adam Kesher, Betty vit un véritable conte de fées. Tout juste arrivée à Hollywood dans le but de devenir « à la fois une star et une grande actrice », elle reçoit rapidement des mains de Coco, l’aimable concierge de sa tante, une convocation pour une audition. Après s’y être préparée en répétant une scène avec Rita, elle se rend à l’audition où elle éblouit toute l’assemblée, en particulier le réalisateur Bob Brooker, le directeur de casting Wally Brown et l’acteur principal Woody Katz. Elle est aussi repérée par une directrice de casting plus cotée qui lui propose « mieux » que Wally Brown et Bob Brooker, qualifiés de has been. Betty se laisse alors conduire sur le plateau de L’histoire de Sylvia North, le film pour lequel Adam Kesher est en train d’auditionner. Elle arrive au moment précis où le réalisateur reçoit la candidate de la Mafia, Camilla Rhodes, et cède au chantage en prononçant les mots fatidiques : « C’est elle » – sous-entendu : c’est elle la fille que je cherche, c’est elle qui aura le rôle. En un échange de regards, quelque chose de l’ordre du coup de foudre semble se passer entre Betty et Adam – c’est en tout cas l’impression que donne ce dernier. Betty quant à elle se rappelle tout à coup qu’elle doit rejoindre Rita, à qui elle a donné rendez-vous après son audition pour poursuivre l’enquête – car l’enquête a progressé.
Tout est parti d’une réminiscence : alors qu’elles prennent un café au Winkie’s (celui-là même où le jeune homme est tombé foudroyé par une tête de Méduse), Rita est frappée par le prénom qu’arbore la serveuse sur son badge : Diane. Ce prénom lui « rappelle quelque chose », et elle finit par se souvenir d’un nom de famille : Selwyn. Les deux femmes cherchent alors dans un annuaire le numéro de téléphone et l’adresse de Diane Selwyn, et par chance il n’y en a qu’une, à Sierra Bonita. Elles appellent mais tombent sur un répondeur laconique qui dit simplement : « Bonjour, c’est moi. Laissez un message ». Rita affirme que ce n’est pas elle mais qu’elle « connaît cette voix », et Betty suggère qu’il pourrait s’agir d’une colocataire. Les deux femmes décident d’aller lui rendre visite et tombent sur une voisine manifestement agacée, qui leur explique qu’il y a eu un échange d’appartements et que Diane Selwyn vit désormais de l’autre côté de la cour, au numéro 17. Rita et Betty s’y rendent, entrent par la fenêtre et découvrent horrifiées le cadavre d’une femme blonde, défigurée par un coup de feu en pleine bouche. Elles prennent la fuite.
De retour dans l’appartement de Tante Ruth, Rita est prise de panique. Elle décide de se couper les cheveux, sans doute pour ne pas être reconnue par les assassins qui la recherchent. Betty l’aide à se faire un nouveau visage en lui offrant une perruque blonde, et l’invite à dormir dans son lit plutôt que sur le canapé. Il se produit alors ce qu’on sentait venir depuis leur première rencontre : elles se rapprochent, s’embrassent et font l’amour avant de s’endormir ensemble. Mais ce moment extatique est de courte durée. Rita profère dans son sommeil des mots énigmatiques : « Silencio ! Silencio ! ». Réveillée par Betty, elle lui dit que « ça ne va pas » et l’invite à la « suivre quelque part ». Elle conduit alors Betty jusqu’à un mystérieux théâtre qui se nomme, justement, le Silencio, où elles assistent côte-à-côte, en larmes, à un inquiétant numéro d’illusionnisme.
L’intrigue devient, à partir de ce moment, de plus en plus étrange. À la fin du spectacle, Betty et Rita découvrent dans leur sac une boîte bleue, qui semble être assortie à la clef bleue de Rita. De retour chez Tante Ruth, Betty disparaît mystérieusement pendant que Rita part chercher la clef dans un placard, puis Rita disparaît à son tour, aspirée dans la boîte bleue, qui elle-même tombe sur le sol. Tante Ruth, sortie d’on ne sait où, fait alors irruption dans l’appartement, qui semble désormais complètement vide : après Betty et Rita, c’est la boîte elle-même qui a disparu.
Après cette première intrusion d’éléments surnaturels, la seconde plus exactement après l’apparition de la tête de Méduse au Winkie’s, nous nous retrouvons dans l’appartement de la morte, Diane Selwyn, à la porte duquel vient frapper le mystérieux cowboy : « Debout ma belle, il est temps de te réveiller ! ». De manière encore plus inexplicable, c’est Betty qui réapparaît, endormie sur les draps roses déjà aperçus en ouverture du film, puis lors de la découverte du cadavre de Diane Selwyn. Obéissant à l’appel du cowboy, elle se réveille et va ouvrir la porte à laquelle, effectivement, quelqu’un est en train de frapper.
« il est temps de te réveiller ! »
Il devient alors manifeste que tout ce qui précédait n’était qu’un rêve, et d’autres signes viennent immédiatement le confirmer. La personne qui frappe à la porte n’est autre que la voisine, rencontrée auparavant par Betty et Rita. Aussi agacée qu’à sa première apparition, elle vient récupérer ses derniers cartons, que « Diane » (c’est le nom qu’elle lui donne) tardait à lui rapporter. Car l’échange d’appartements a effectivement eu lieu, mais Diane Selwyn n’est pas morte : elle est bien vivante, sous les traits de la jeune femme que nous connaissions jusqu’à présent sous le nom de Betty. Dès lors, et jusqu’à la fin du film, des plans de Diane prostrée alternent avec les hallucinations et les souvenirs qui s’enchaînent dans son esprit – et qui nous permettent de reconstituer progressivement son histoire.
Juste après le départ de la voisine, Diane, prise d’une hallucination, voit apparaître celle que nous connaissions jusque-là sous le nom de Rita, et dont l’identité perdue s’avère être Camilla Rhodes – ce nom que portait jusqu’à présent l’actrice blonde imposée à Adam Kesher par la Mafia : « Camilla, tu es revenue ! ». Une fois le mirage dissipé, Diane retrouve le visage fermé, tendu, presque défiguré par la souffrance, qu’elle a depuis son réveil, et qui contraste singulièrement avec le visage radieux qu’elle avait lorsqu’elle se prénommait Betty. Nous comprenons qu’il y a bien eu une histoire d’amour entre les deux femmes mais qu’à l’heure qu’il est Camilla est « partie ». Nous venons par ailleurs d’apprendre par la voisine que deux agents de police sont « repassés » à la recherche de Diane – et cette allusion nous rappelle l’image des deux agents sur les lieux de l’accident, au tout début du film. Il semble donc qu’un événement a bien eu lieu, probablement autour de Camilla, probablement à Mulholland Drive, que cet événement est suffisamment grave pour que des agents de police mènent une enquête, et que Diane est suffisamment impliquée pour rêver des deux inspecteurs – et aussi pour les fuir, en changeant d’appartement.
Diane s’approche ensuite d’un canapé vert avec sa tasse de café, et cette situation lui rappelle un épisode passé : le moment où, sur ce même canapé, alors qu’elle apportait à boire à Camilla, celle-ci lui a annoncé brutalement la fin de leur liaison (« On ne fera plus ça »). Le souvenir d’une autre parole de Camilla ce jour-là (« J’avais déjà essayé de te le dire ») rappelle à Diane un autre moment tragique : le jour où, sur un tournage, son amante, qui s’avère être une actrice et tenir le premier rôle dans un film d’Adam Kesher, a embrassé le réalisateur sous ses yeux. Nous retrouvons ensuite Diane prostrée sur le canapé vert, seule face à une clef bleue dont la signification nous échappe toujours, en train de se masturber en pleurant.
Puis c’est un autre souvenir qui nous est livré : un appel de Camilla qui convie Diane à une fête. C’est d’abord la boîte vocale de Diane qu’on entend dire : « Bonjour, c’est moi. Laissez un message ». La voix et la formule laconique du répondeur sont identiques à celles de la mystérieuse Diane Selwyn, dans le rêve. Lorsque Betty faisait remarquer à Rita que « ça doit faire bizarre de s’appeler soi-même », nous avions d’abord compris : « ça doit te faire bizarre de t’appeler toi-même » (l’hypothèse de leur enquête étant alors que « Diane Selwyn » était l’identité oubliée de Rita). Mais on se souvient désormais que c’était Betty qui tenait le combiné et qui prononçait cette phrase, et qu’en en sens c’était bien elle qui était en train de « s’appeler elle-même » – puisque « Diane Selwyn » est sa véritable identité. Et Rita avait également raison, toujours dans le rêve, de répondre : « Non, ce n’est pas moi, mais je connais cette voix. »
La suite de la séquence nous apprend enfin de quoi exactement Mulholland Drive est le nom. Ce lieu mystérieux, dont Rita se souvenait simplement qu’elle s’y rendait au moment où elle avait eu son accident, est tout simplement le lieu où se trouve la somptueuse villa d’Adam Kesher. C’est là pour le moment que se tient une fête au cours de laquelle Diane vit une ultime série d’humiliations, de la part d’Adam et Camilla qui annoncent leur mariage, mais aussi de la mère du cinéaste, qui se fait appeler Coco – et que nous avions déjà rencontrée avec le même surnom mais dans un autre rôle : celui d’une excentrique mais sympathique gardienne d’immeuble. La mère du cinéaste, ce soir-là, ne répond au « bonjour » de Diane, arrivée en retard, que par un glaçant « Ah, la voilà ! Allez, on mange, je meurs de faim ! », suivi d’un regard insistant et accusateur qui pousse la retardataire à balbutier : « Excusez-moi, c’est de ma faute ». Et pendant le repas, elle multiplie les marques de condescendance : « Comme ça, vous débarquez de l’Ontario ? », « Ah, votre tante travaillait à Hollywood ? » – sans oublier un petit tapotement maternaliste sur la main de Diane lorsque celle-ci évoque ses échecs professionnels. Lors de cette fête à Mulholland Drive, nous retrouvons également la jeune femme blonde que nous connaissions jusque-là sous le nom de Camilla Rhodes, candidate de la Mafia, et nous la voyons embrasser la véritable Camilla sous les yeux de Diane. Nous voyons enfin passer, au second plan, le fameux cowboy.
Un ultime souvenir de Diane nous éclaire sur le sens de la clef bleue, et vient donner une dimension encore plus tragique à l’histoire qui peu à peu se dévoile sous nos yeux. Diane se remémore le contrat qu’elle a passé avec un tueur (le même que celui du rêve), dans un Winkie’s (le même encore que dans le rêve), sous les yeux d’une serveuse (la même toujours) dont le prénom, arboré sur son badge, n’est plus Diane mais Betty. Le tueur montre une clef bleue à Diane et lui explique que cette clef se trouvera « à l’endroit convenu » quand « le travail sera fait ». La victime du contrat est Camilla Rhodes, la vraie, la brune : Diane montre au tueur une photo de la star en prononçant des mots eux aussi familiers – « C’est elle ».
Les derniers plans du film nous montrent Diane à nouveau prostrée chez elle, face à une clef bleue, dont nous comprenons enfin la signification effroyable. On frappe à sa porte, probablement les deux agents de police qui la recherchent, et Diane est prise à nouveau d’hallucinations : elle voit se glisser sous la porte deux petits gnomes, qui s’avèrent être, en modèle réduit, le couple de vieillards aperçu dans la séquence d’ouverture du film puis dans la séquence de l’aéroport. Prise de panique, Diane fuit les deux gnomes qui lui foncent dessus, hilares et menaçants, elle se replie dans sa chambre, ouvre sa table de chevet, saisit son arme et se tire une balle dans la bouche. Le rêve était donc un rêve prémonitoire, et la mort de Diane Selwyn une mort annoncée : nous retrouvons Diane morte, dans la même position et sur les mêmes draps roses que la Diane Selwyn du rêve – et le film s’achève comme il a commencé : sur une image en surimpression du visage radieux de Diane, désormais accompagné de celui de Camilla.
« il ne m’a pas trouvée bonne »
De l’histoire véritable de Diane, le film ne nous montre donc rien de manière directe. Diane en effet ne quitte pas les deux pièces de son appartement durant toute la durée du film, et ses faits et gestes se limitent à peu de choses : en tout et pour tout elle titube jusqu’à son lit, s’endort et rêve, se réveille, se déplace jusqu’à la porte, ouvre à sa voisine, lui marmonne quelques mots, lui rend ses cartons, part dans sa cuisine, se prépare un café, apporte le café dans le salon, s’affale sur le canapé vert, se perd dans ses pensées, reste prostrée devant la clef bleue puis, assaillie par les souvenirs, les remords et les hallucinations, court dans sa chambre et se tire une balle dans la bouche.
Mais si Diane ne fait à peu près rien entre le moment où elle s’effondre sur son lit et celui où elle y retourne pour mettre fin à ses jours, sa vie psychique en revanche est extrêmement riche : elle rêve (pendant les deux premières heures du film), elle hallucine (trois fois : le retour miraculeux de Camilla, l’apparition terrifiante des petits gnomes sous sa porte, puis celle de la tête de Méduse) et elle se remémore le passé (une réminiscence avant l’endormissement, celle du concours de danse en pré-générique, puis six autres après son réveil : la rupture sur le canapé, l’humiliation sur le tournage, la dispute à la porte, les moments de solitude et de masturbation triste, l’humiliation à la fête de Mulholland Drive, et enfin le contrat avec le tueur). Et c’est à partir de ces séquences rêvées, fantasmées ou remémorées qu’on peut reconstituer toute l’existence de Diane Selwyn – les séquences de souvenirs nous apportant les éléments les plus objectifs, tandis que les moments rêvés ou hallucinés nous font ressentir l’intensité des pulsions, et donc l’impact affectif qu’ont pu avoir sur Diane les divers épisodes évoqués.
La reconstitution d’un récit suppose dès lors un réagencement dans le temps des différentes séquences du film, puisque les épisodes de la vie de Diane nous sont montrés dans un ordre qui ne correspond pas à l’ordre dans lequel ils se sont enchaînés. Ce changement d’ordre ne facilite pas la compréhension : on a beau par exemple voir revenir la clef bleue dès le réveil de Diane, il est impossible d’en comprendre la signification tragique (la mort de Camilla) jusqu’à ce que le souvenir du contrat avec le tueur vienne la révéler. L’état de torpeur, de souffrance et de nervosité dans lequel se trouve Diane à son réveil ne peut donc être pleinement compris que de manière rétroactive : avant le flashback du contrat de meurtre, nous n’avons affaire qu’à un état de délabrement inexpliqué, qui ne passe que par le corps de l’actrice, sans qu’aucune compréhension psychologique ne soit possible. Mais on aurait tort de voir dans cet apparent désordre le caprice d’un artiste prenant un malin plaisir à mener en bateau spectateurs et spectatrices. Car l’apparente liberté prise avec l’enchaînement des événements cache en fait le respect scrupuleux d’une chronologie – mais d’une chronologie qui intègre la vie psychique et onirique : nous suivons les derniers moments de Diane Selwyn, le rêve succède à l’endormissement puis le réveil interrompt le rêve et, de même que nous avons suivi physiquement Diane jusqu’au fond de l’oreiller rose quand elle s’est endormie, nous la suivons psychiquement après son réveil. Nous voyons comment les idées s’enchaînent dans son esprit – comment par exemple Diane s’approche de son canapé vert, un plateau à la main, et se trouve entraînée, par association d’idées, vers le souvenir de sa rupture avec Camilla, qui s’était jouée sur le même canapé vert avec le même plateau.
Et voici ce que finalement on peut reconstituer de l’existence de Diane Selwyn. Née à Deep River, Ontario, elle gagne un concours de danse et part tenter sa chance à Hollywood. Elle se présente à une audition pour un film de Bob Brooker : L’histoire de Sylvia North, mais le réalisateur ne la trouve « pas bonne » (tout cela, c’est Diane elle-même qui le raconte à la soirée d’Adam Kesher). C’est une autre, Camilla Rhodes, qui décroche le rôle, sans doute parce qu’elle est meilleure actrice (« Camilla était magnifique dans ce rôle », commentera un convive d’Adam Kesher), ou bien parce qu’elle a couché (ce que suggère la séquence rêvée de l’audition pour Bob Brooker, quand le libidineux Woody Katz fait allusion à une « brunette » avec qui il a « joué la scène collé-serré ») [2]. Diane devient malgré tout l’amie de Camilla, qui profite de son succès grandissant pour lui obtenir des petits rôles (toujours selon son propre récit). Elle devient aussi son amante (ce que Diane se garde bien d’évoquer dans son récit chez Adam Kesher, mais que nous apprenons par d’autres séquences de souvenir), jusqu’à ce qu’un jour, sur un tournage, elle voie Camilla embrasser Adam sous ses yeux. Elle refuse de comprendre le message, ce qui pousse Camilla à lui dire explicitement, chez elle, sur le canapé vert, qu’elles ne se verront plus, en tout cas plus comme amantes. Camilla l’invite peu après à une fête qu’elle donne à Mulholland Drive dans la villa du cinéaste. Diane s’y rend, sans doute sous le charme de ses paroles encore enjôleuses (« Viens, c’est tellement important pour moi ») – ou tout simplement parce qu’elle l’aime encore – et elle y subit une longue série d’humiliations : de la part de l’hôte Adam Kesher, de sa mère Coco, et de Camilla elle-même. Ces affronts amènent Diane à engager un tueur, au Winkie’s, pour faire assassiner Camilla. Elle trouve ensuite « à l’endroit convenu » une clef bleue qui lui confirme que « le travail a été fait », puis elle échange son appartement avec celui de sa voisine – sans doute pour échapper aux visites importunes des inspecteurs qui enquêtent sur la mort violente de la star. C’est à ce moment que Diane, enfermée chez elle depuis trois semaines (selon les mots de sa voisine), se remémore le concours de danse qu’elle a remporté et s’endort.
Le rêve peut alors commencer. Il sera interrompu par la voisine frappant à sa porte. Diane ira lui ouvrir, lui rendra ses derniers cartons, apprendra que les deux inspecteurs sont repassés puis se perdra encore un peu dans ses souvenirs, jusqu’à ce que la vue de la clef bleue et l’arrivée des deux inspecteurs frappant à la porte déclenchent ce que son rêve annonçait déjà : dans son lit couvert de draps roses, Diane Selwyn se tuera d’une balle dans la bouche.
« quelqu’un est en danger »
L’histoire s’achève par un suicide mais d’une certaine manière, et depuis longtemps, Diane est déjà morte. Les souvenirs que le film nous donne à voir ne forment rien d’autre que le récit de ses trois morts affectives : l’audition ratée, la perte de Camilla, la fête sordide de Mulholland Drive.
Diane meurt une première fois lorsque le rôle de Sylvia North, dont elle rêvait, lui échappe au profit de Camilla Rhodes, jugée meilleure qu’elle par le réalisateur Bob Brooker. C’est le deuil d’un rêve d’enfant, que Betty a formulé à Rita dans l’appartement de Tante Ruth : « devenir à la fois une star et une grande actrice », et ce deuil est un deuil impossible, toute consolation étant interdite, y compris le plaisir simple de détester sa rivale – puisque celle-ci n’est autre que Camilla, la personne dont, au même moment, elle tombe amoureuse. « C’est Camilla qui a eu le rôle, et c’est là qu’on est devenues amies » : en interdisant toute expression du ressentiment, tout défoulement haineux contre sa rivale, la relation amoureuse naissante bloque tout le travail de deuil – et cela d’autant plus que Camilla aide Diane à obtenir des rôles dans ses films. En une seule et même personne coexistent ainsi la rivale qui lui a piqué le premier rôle et l’amie-amante qui lui trouve du boulot.
Diane meurt une seconde fois le jour où, en plein tournage, la femme qu’elle aime embrasse sous ses yeux le réalisateur Adam Kesher. Double trahison : Camilla quitte Diane, mais elle quitte aussi une liaison singulière et clandestine pour revenir sous les projecteurs, dans le droit chemin hollywoodien – cet ordre symbolique hétérosexuel et conjugal qui veut qu’une belle actrice épouse un réalisateur prestigieux.
Et c’est précisément pendant une grande cérémonie hollywoodienne, à Mulholland Drive, que Diane meurt une troisième fois, humiliée par Adam Kesher (qui annonce triomphalement son mariage avec Camilla), par sa mère Coco (qui prend Diane de haut : « Alors comme ça, vous débarquez de l’Ontario ? ») et bien entendu par Camilla elle-même (qui embrasse sur la bouche une inconnue, sous ses yeux et en la défiant du regard). L’interrogation insistante, dans toute la partie rêvée, sur « l’accident » qu’il y aurait eu à Mulholland Drive reçoit ici une réponse affirmative : il y a bien eu un accident, et la formule doit même être entendue comme un euphémisme car c’est un traumatisme, une profonde blessure narcissique qui a eu lieu pour Diane dans la villa d’Adam Kesher.
C’est justement parce que Diane est déjà morte trois fois, et parce qu’elle se sait condamnée à une quatrième – et véritable – mort, que l’ambiance du film, pendant ses deux premières heures, est aussi ambivalente : le rêve est à la fois ce par quoi Diane réenchante sa vie et ce par quoi elle anticipe sa mort. Ultime répit de la « morte en sursis » qu’est Diane, sa vie de rêve se trouve malgré tout parasitée par de multiples signes annonciateurs qui menacent constamment de tout arrêter, comme la visite de la voisine Louise Bonner, la mort du jeune homme au Winkie’s, la découverte du cadavre de Diane Selwyn à Sierra Bonita, le cauchemar de Rita ou enfin le spectacle macabre du Silencio.
Ces signes annonciateurs sont toutefois transformés suffisamment par le travail onirique pour être méconnaissables, ne pas rompre le charme et interrompre le rêve. Lorsque par exemple Louise Bonner, la voisine que la concierge Coco présente comme moitié folle moitié voyante, vient sonner à la porte de Betty, tout son être annonce la réalité dans ce qu’elle a de désagréable, voire d’insupportable et de hideux. Son visage fripé et ses cheveux en bataille, d’abord, rappellent l’horrible tête de Méduse du Winkie’s – qui elle-même (nous allons y venir) symbolise le monstrueux contrat passé audit Winkie’s entre Diane et le tueur. Par son action ensuite, Louise annonce le réveil douloureux de Diane, qui sera bel et bien tirée de son rêve et ramenée à son atroce réalité par une voisine venue frapper à la porte. Par ses paroles enfin, Louise Bonner annonce explicitement que « quelqu’un est en danger », et lorsque Betty se présente, elle proteste : « Non, ce n’est pas toi, il y a quelqu’un d’autre » – et il y a effectivement quelqu’un d’autre derrière la jeune femme pleine de vie, de gaité et d’ambition qu’est Betty, et cet autre est effectivement en danger. Il y a d’abord Rita, cachée plus loin dans l’appartement, mais il y a aussi et surtout Camilla qui se dissimule derrière un prénom emprunté à Rita Hayworth – et de fait, cet autre-là est plus qu’en danger : Camilla a été assassinée. Il y a enfin Diane, la meurtrière, qui se dissimule derrière l’innocente et joyeuse Betty, et elle aussi est en danger : recluse depuis trois semaines, traquée par la police, détruite par le remords, elle n’est qu’une suicidée en sursis. Tout cela en un sens est beaucoup trop clair, il faut donc que Coco intervienne pour sauver in extremis le rêve et éviter le réveil de Diane : elle parvient à interrompre Louise Bonner, à la renvoyer littéralement chez elle, à la disqualifier en la présentant comme folle, puis à relancer le rêve avec une bonne nouvelle – Betty est convoquée dès le lendemain pour une audition. Comme l’accident de voiture « irréel » qui ouvre le film, l’arrivée de Coco a quelque chose d’un deus ex machina.
« la fille manque »
Au-delà des prophéties de Louise Bonner, la réalité affleure au sein même du rêve de multiples façons, toujours suffisamment discrètes – ou oniriquement modifiées, maquillées, déguisées – pour que le rêve ne tourne pas au cauchemar et que Diane ne se réveille pas. Quand par exemple Betty explique à Rita que « ce n’est pas bon de dormir après un accident », on peut considérer que Diane en train de rêver se parle à elle-même, car telle est bien sa situation : après cet « accident » qu’est effectivement le meurtre de Camilla (puisque Diane le regrette), la coupable s’est réfugiée dans le sommeil et le rêve – ce qui effectivement n’est pas très bon, c’est le moins qu’on puisse dire. Rita de son côté espère se remettre de son accident en dormant mais réalise à son réveil qu’elle est tout aussi perdue qu’avant et, en larmes, elle confie à Betty : « Je croyais qu’à mon réveil, ça serait différent ! » – et là encore on peut considérer que Diane en train de rêver se parle à elle-même, par l’intermédiaire de Rita. Car c’est bien elle, Diane Selwyn, qui se sent perdue depuis trois semaines, c’est bien elle qui tente de se réfugier dans le sommeil en espérant qu’à son réveil « ça sera différent », et c’est bien elle qui se rend compte à chaque réveil que rien n’a changé : la clef bleue est toujours sur sa table basse, lui rappelant son crime et la disparition de l’être aimé.
Parmi les signes annonciateurs il y a aussi, dans les propos que s’échangent aussi bien les agents de police que les membres de la Mafia, ce leitmotiv lancinant : « La fille manque » – car effectivement, Camilla manque gravement, tragiquement, atrocement à Diane. Ou encore ce constat que fait Betty lorsqu’elle part chercher dans l’annuaire l’adresse de Diane Selwyn : « Il n’y en a qu’une seule » – ce qui peut s’entendre comme un rappel : Betty et Diane ne sont effectivement qu’une seule et même personne, et la Diane Selwyn morte que Betty va découvrir à Sierra Bonita n’est donc rien d’autre que sa propre mort anticipée. Il y a aussi cette réponse de Betty lorsque Tante Ruth, au téléphone, s’inquiète de la présence d’une inconnue dans sa maison et lui demande d’appeler la police : « Non, on n’a pas besoin de la police ! » – et là encore on entend Diane parler : commanditaire d’un meurtre, elle a de très sérieuses raisons de se passer de la police, et c’est d’ailleurs pour cela qu’elle s’est réfugiée dans un autre appartement (dans son rêve, de Sierra Bonita à Havenhurst chez Tante Ruth, mais aussi dans la réalité : de l’appartement 12 à l’appartement 17). Il y a encore, après la nuit d’amour, cet échange entre Rita prise de panique et Betty qui tente de la rassurer : « Tout va bien ! – Non, ça ne va pas ! » – car effectivement rien ne va : ni pour Camilla qui est morte depuis trois semaines, ni pour Diane qui est coupable du meurtre et ne le supporte pas.
Enfin, d’une manière beaucoup plus explicite, qui annonce donc la fin imminente du rêve, le magicien du Silencio nous avertit que de toute façon « tout n’est qu’illusion », et la chanson interprétée par Rebekah del Rio vient comme un rappel de la réalité : elle s’intitule Llorando (En pleurs), elle est chantée a capella, comme pour rappeler l’absolue solitude de Diane, et la chanteuse brune s’écroule au milieu de son playback, comme pour mimer la mort d’une autre brune – Camilla. Betty et Rita assistent à cette fin de spectacle en pleurant, comme si elles avaient compris le message, comme si elles devinaient désormais que le rêve était sur le point de s’achever. Rita pleure comme si elle pressentait qu’elle allait devoir redevenir Camilla et donc retourner au royaume des morts où Diane l’a expédiée. Betty pleure comme si elle pressentait qu’elle allait redevenir Diane, la femme défigurée par la souffrance qui, depuis trois semaines, vit recluse dans son appartement, à Sierra Bonita, et tente d’oublier dans le sommeil qu’elle a mis à mort l’être aimé.
« dans ce Winkie’s-là »
Parmi les séquences inquiétantes qui viennent troubler le déroulement idyllique du rêve, la plus étrange est sans doute la séquence du Winkie’s. « Je voulais venir ici, dans ce Winkie’s-là » déclare d’emblée le jeune homme : le lieu est donc introduit, inauguré, comme un important lieu de mémoire, presque aussi important, matriciel, traumatique que Mulholland Drive. Et pour cause : nous découvrons à la fin du film que c’est en ce lieu que Diane a passé son contrat avec le tueur. Et il se trouve justement qu’au moment précis où est passé le contrat, son regard croise celui de l’étrange jeune homme, qui se tient à la caisse, en train de payer. Il semble la regarder bizarrement : aurait-il deviné quelque chose ? Soupçonne-t-il ce qu’elle est en train de faire ? Évidemment non, c’est une question absurde – mais dans une telle situation, Diane ne peut pas ne pas se la poser.
Que signifie le retour de ce jeune homme dans le rêve de Diane ? Pour déchiffrer le sens de cette séquence, il faut avoir en tête la notion freudienne de déplacement. Diane déplace, au sens littéral, le jeune homme : de la caisse, près de la sortie, où il se trouvait dans la réalité, il passe à l’intérieur du Winkie’s, attablé à l’endroit précis où se tenaient Diane et le tueur, et il raconte à un ami un rêve que lui-même a fait, et qui se passait dans ce même Winkie’s. Occupant la même table que Diane et le tueur, il prend donc leur place : on peut le considérer comme un substitut des deux comploteurs. Quant à son ami, le jeune homme à son tour le déplace dans le rêve qu’il raconte, puisqu’il le fait se tenir debout, à la caisse – à la place donc que lui-même a occupé dans la réalité. L’ami joue donc le rôle qu’a joué le jeune homme dans la réalité : celui du témoin innocent, présent sur les lieux mais aveugle à la réalité hideuse dont les clients attablés sont témoins (et même acteurs). Le jeune homme raconte en effet avoir vu, de sa table, une chose que les autres personnes présentes dans le Winkie’s ne voyaient pas : un visage atroce, quelque chose comme une tête de Méduse, qu’il espère « ne plus jamais revoir ». Son ami, debout à la caisse, le regardait fixement (aussi fixement que le jeune homme lui-même avait regardé Diane dans la réalité), mais sans apercevoir la tête de Méduse. Une fois ce rêve raconté à son ami, le jeune homme sort du Winkie’s, il aperçoit une nouvelle fois la tête de Méduse, et comme lui-même l’avait pressenti, il ne le supporte pas : il s’effondre – mort ou simplement évanoui, cela reste indécidable.
Une signification finalement assez simple apparaît si l’on se réfère au rôle joué par la tête de Méduse (Gorgone) dans la mythologie grecque : figurer l’indicible, l’innommable, la mort, tout ce qui dans l’existence humaine est étrange, inquiétant, insupportable [3]. L’apparition de la tête de Méduse derrière le Winkie’s peut en somme être vue comme un moyen allégorique de rappeler qu’il s’est passé quelque chose d’atroce dans ce Winkie’s, mais de le rappeler de manière indirecte, avec suffisamment de déplacements et de déguisements (notamment le recours au symbole antique) pour que l’évocation ne soit pas trop bien comprise et que le rêve ne soit pas interrompu. Car, de fait, dans « ce Winkie’s-là » et pas un autre, Diane et le tueur ont bien « vu » une chose innommable que les autres personnes présentes, et notamment le jeune homme debout à la caisse, n’ont pas vu : un meurtre. Cette « chose hideuse » dont a rêvé le jeune homme, et qu’a symbolisé la tête de Méduse, c’est bien cela : la mise à mort d’une femme par une autre, qui était censée l’aimer.
La séquence est, de fait, prémonitoire : Diane comme le jeune homme du rêve ne pourra jamais « revoir à nouveau », et à l’état de veille, la réalité hideuse qu’elle a entrevue au Winkie’s. Ce meurtre qu’en un moment d’égarement elle a pu envisager, concevoir, et même commanditer, elle ne pourra pas y repenser, l’affronter, l’assumer, une fois réalisé. Le travail onirique est justement ce qui lui permet de ne pas voir frontalement cette réalité hideuse et insupportable, mais à son réveil elle y sera confrontée brutalement en apercevant la clef bleue sur sa table basse, et comme le jeune homme elle s’effondrera : prise de panique, elle perdra tout contrôle en se remémorant les épisodes traumatiques successifs qui l’ont amenée à commettre l’irréparable. La tête de Méduse réapparaîtra d’ailleurs, en hallucination cette fois-ci, et Diane courra vers sa chambre se tirer une balle dans la bouche. Comme le jeune homme, et comme n’importe quel être humain, elle n’aura pas pu faire face à l’innommable.
« et ça ouvre quoi ? »
La clef bleue elle aussi renvoie à la mort, et le symbole dans ce cas n’est pas une production du travail onirique. Cette clef est réellement le signe du meurtre de Camilla : c’est l’objet réel choisi réellement par un tueur bien réel pour signifier à Diane que « le job a été fait ». Ce qu’en revanche le travail onirique invente, c’est la boîte, autrement dit : ce que la clef permet d’ouvrir. Cette boîte bleue est en somme la réponse fictive à une question réelle, une question que s’est réellement posée Diane : au moment où le tueur lui a montré la clef bleue, elle lui a demandé naïvement ce que cette clef ouvrait. Le tueur s’est contenté de ricaner – manière inélégante de rappeler à sa cliente ce qu’elle sait déjà au fond d’elle-même : qu’il n’y a, en cette matière, rien à « ouvrir ». La clef bleue symbolise le meurtre de l’être aimé, et s’il existe une boîte que cette clef permet d’ouvrir, alors cette boîte représente les perspectives ouvertes par le meurtre de l’être aimé – et il est évident que ces perspectives ne sont que le néant, l’anéantissement, la mort.
Cette dimension morbide est confirmée par la séquence du Silencio, où cette boîte bleue apparaît pour la première fois, comme par magie, dans le sac à main de Rita. Car le Silencio, espace nocturne, glacial et bien entendu silencieux, perdu au fond d’un immense parking, est une représentation assez plausible du monde des morts – ou des Enfers, surtout si l’on songe à l’animateur principal du spectacle, qui possède tous les attributs d’un Diable : le costume impeccable, la petite barbe bien taillée, les yeux exorbités, la diction et la gestuelle d’un grand imprécateur [4]. Rita l’a d’ailleurs laissé entendre, en y invitant Betty dans ces termes : « Tu dois venir avec moi quelque part » – une phrase que nous pouvons entendre ainsi : rejoins-moi là où je suis, là où tu m’as envoyée, une invitation que Diane honorera à son réveil, en se suicidant. Et de fait, c’est bien comme un « anéantisseur » que fonctionne la boîte bleue : à peine rentrée à la maison, Betty disparaît, laissant Rita seule avec la boîte, et à peine ouverte celle-ci aspire Rita, comme dans un trou noir. Le rêve s’arrête alors, faute de personnages – et là encore c’est le contrat de meurtre qui est rejoué sous forme allégorique : Betty s’éclipse en laissant Rita se faire anéantir par la boîte bleue en son absence, de même que dans la réalité, en payant un tueur professionnel, Diane a organisé la disparition de Camilla tout en ne se rendant pas elle-même sur le lieu du crime.
La boîte ouverte par cette clef bleue peut aussi symboliser le rêve, qui est le seul sursis que peut s’offrir Diane avant de rejoindre Camilla au royaume des morts. Le seul espace qu’elle peut encore « ouvrir » et investir, où elle peut encore se réfugier après un acte aussi irréversible et monstrueux que le meurtre de l’être aimé, c’est en effet le monde du sommeil et du rêve, où l’irréparable peut être réparé. La boîte bleue représente en somme, et sous toutes ses formes, l’envers de la vraie vie : soit le rêve et l’illusion, soit la mort. Et sans doute peut-on voir aussi dans cette boite la « chambre noire », camera obscura, et par métonymie la grande machinerie cinématographique, l’usine à rêves qu’est Hollywood – auquel cas la boîte bleue nous dit : Hollywood fait rêver, et Hollywood tue. Ou même, nous y reviendrons : Hollywood tue en faisant rêver.
« on ne s’arrête pas là »
Ces mots prononcés par Diane dans le taxi qui la mène à Mulholland Drive reviennent au tout début du rêve, au moment où Rita doit se faire assassiner – et de fait, l’histoire ne doit pas s’arrêter là. Elle ne doit pas se finir sur ces deux dénouements irréversibles qui ont eu lieu à Mulholland Drive : l’annonce du mariage de Camilla Rhodes et Adam Kesher, puis le meurtre de Camilla. En faisant revivre Camilla sous les traits de Rita, en composant une histoire d’amour parfaite et en réparant les offenses subies, le rêve va permettre à Diane de réécrire son histoire en réalisant ses rêves d’actrice et ses idéaux d’amour pur contre un monde – en gros : le monde d’Hollywood – qui les a massacrés.
Au moment où elle s’endort, Diane possède la clef bleue – qu’elle retrouvera sur sa table à son réveil – et elle sait donc que le tueur a fait son travail. Elle sait par conséquent que Camilla, la femme qu’elle aime, est morte par sa faute. Mulholland Drive est donc le lieu de ses morts affectives mais aussi le lieu d’un meurtre bien réel : c’est bien là (chez son nouveau mari) que Camilla se rendait lorsqu’elle a été tuée, et c’est même parce qu’elle y allait qu’elle a été tuée – c’est d’ailleurs la seule chose dont se souviendra Rita après son accident : « Mulholland Drive, c’est là que j’allais ». Rongée par le remords et le manque, Diane n’a qu’un désir : revenir sur son acte, faire revenir Camilla pour que tout recommence – un désir qui s’exprime de manière frontale, brutale, le temps d’une brève hallucination peu après son réveil (« Camilla, tu es revenue ! ») et par le rictus de souffrance qui s’empare de son visage un temps illuminé, une fois que le mirage s’est dissipé. Pour que tout « revienne », ou plutôt pour que toute l’histoire soit rejouée autrement, il faut donc avant toute chose ramener Camilla à la vie. Il faut commencer par la fin, en rejouant la dernière séquence : il y aura bien un projet de meurtre dans le rêve, il aura bien lieu à Mulholland Drive, mais tout échouera au dernier moment grâce à un improbable accident de voiture en forme de deus ex machina.
La symétrie, de ce point de vue, est saisissante, non seulement entre les deux arrivées à Mulholland Drive, l’arrivée de Rita au début du film et celle de Diane à la fin (dans le même taxi, dans la même ambiance nocturne, sur la même musique douce, triste, inquiétante d’Angelo Badalamenti), mais aussi et surtout entre les deux séquences qui suivent cette arrivée : une montée vers la mort et une redescente sur terre, chez les vivants. Cueillie à la sortie de son taxi par Camilla, Diane monte, le corps figé par l’angoisse, à travers les arbres, comme on monte sur le bûcher ou sur l’échafaud – avec Camilla qui prend sa main et l’invite à la suivre, comme une allégorie de la Mort. Et à l’opposé, après l’accident miraculeux, Rita sort en titubant de la voiture en feu comme des flammes de l’Enfer, elle s’éloigne de Mulholland Drive et redescend vers les lumières de la ville – le monde des vivants.
« on dira qu’on est quelqu’un d’autre »
Pour que l’histoire d’amour entre Diane et Camilla puisse revenir et se rejouer autrement, en mieux, il ne suffit pas que Camilla revienne à la vie : il faut que les comptes soient soldés, et les offenses punies. Diane doit prendre sa revanche sur Camilla. Mais elle ne peut pas simplement la maltraiter comme celle-ci l’a maltraitée : la pure et simple vengeance n’est pas la solution – Diane est d’autant mieux placée pour le savoir qu’elle a expérimenté, pour de vrai, l’option de la vengeance la plus radicale, implacable, basique : la mise à mort. C’est une revanche plus complexe qui s’imposait, pour la simple raison que Diane éprouvait à l’égard de Camilla des sentiments extrêmes mais contradictoires. De la rancœur, de la colère, de la haine sans doute, pour le mal que Camilla lui avait fait, mais aussi de l’amour – et l’amour ne disparaît pas facilement. Le travail onirique de Diane doit donc construire une place à la fois pour une Camilla détestable, qui sera maltraitée, et pour une autre aimable, qui sera cajolée.
Le problème est que dans la vraie vie, c’est une seule et même femme qui a été aimée et détestée. Cette contradiction invivable, invivable en tout cas pour quiconque a été, comme Diane Selwyn, façonné par l’idéal hollywoodien de l’amour pur et sans mélange, le travail onirique se charge de la supprimer, par un nouveau déplacement. Camilla Rhodes va se diviser en deux : d’un côté, la femme que Diane n’a jamais cessé d’aimer perd son nom et devient amnésique (à cause du choc de l’accident de voiture, ou plutôt grâce à lui), elle se donne un nom sans histoire (le premier prénom qu’elle croise, sur une affiche : Rita) et se tient à distance d’Hollywood – qui devient le domaine réservé de Betty (la scène de la répétition est éloquente : Diane rêve une Rita sans goût ni talent pour le jeu, qui se contente d’ânonner péniblement ses répliques). De l’autre, le nom maudit de Camilla Rhodes, celui de la star qui tient le haut des affiches, reste présent dans le rêve (il y a bien une Camilla Rhodes, qui rafle effectivement le rôle auquel Betty pouvait prétendre), mais ce nom est détaché du visage de l’être aimé. A ce nom maudit le rêve se charge, par cette autre opération onirique très classique que Freud nomme condensation, d’associer un visage maudit – si possible un visage sans nom, pour que tout s’emboîte bien. Ce visage maudit et sans nom est tout trouvé : ce sera cette inconnue blonde qui a fait à Diane l’affront d’embrasser Camilla sous ses yeux, à Mulholland Drive.
Mais pour que tout s’arrange, il ne suffit pas que Camilla devienne Rita : Diane aussi doit changer de nom. Car dès l’instant où elle condamne à mort la femme qu’elle aime, elle cesse pour ainsi dire d’être elle-même et devient, à ses propres yeux, un « autre » détestable qu’elle doit par tous les moyens mettre à distance. « Diane » en somme est aussi devenu un nom maudit.
Que Diane se déteste d’avoir mis à mort l’être aimé, c’est ce que confirme le texte de l’audition pour Bob Brooker : la jeune femme jouée par Betty menace de mort son amant, et lorsque celui-ci la nargue (« On te mettra en prison ! »), elle éclate en sanglots et s’écrie : « Je te déteste ! Je nous déteste tous les deux ! ». Il n’est pas anodin que cette scène soit d’abord répétée par Betty avec Rita dans le rôle de l’amant : la menace de mort peut être prise au pied de la lettre. Lorsque Betty récite ces menaces et dit « je te déteste », c’est bien elle qui parle, ou plus précisément Diane (sa véritable identité), et non son personnage, et c’est bien à Rita qu’elle s’adresse, ou plus précisément à Camilla, et non simplement à cet amant fictif que Rita interprète. Et lorsque Betty ajoute « je nous déteste tous les deux », c’est bien des deux personnes physiquement présentes lors de la répétition qu’elle parle, et non des personnages du script. « Je nous déteste tous les deux » peut en tout cas être entendu ainsi : je te déteste, Camilla, pour ce premier rôle que tu m’as volé, pour ce cœur que tu as brisé, pour ce Kesher que tu as épousé, pour cette blonde que tu as embrassée sous mes yeux, et je me déteste aussi, moi Diane, pour ce meurtre que j’ai commis [5].
Le changement d’identité s’impose donc pour Diane, afin de pouvoir satisfaire ce besoin narcissique élémentaire de toute existence : s’aimer soi-même un minimum. Et le prénom de Betty s’impose pour des raisons assez évidentes. Diane a rencontré une serveuse portant un badge « Betty » dans l’immédiat après-coup de ce moment fatidique où elle a perdu toute estime d’elle-même, ce moment où « Diane » est devenu un prénom impossible à porter : celui du contrat avec le tueur. Le travail onirique vient donc opérer le même mouvement de déplacement/condensation que sur Camilla : il divise Diane en deux en séparant le visage du nom, puis il associe le visage sans nom à un autre nom, et le nom sans visage à un autre visage. L’opération est d’ailleurs plus simple qu’avec Camilla puisqu’un strict échange a lieu : Diane prend le prénom de la serveuse Betty, premier prénom féminin – et donc première identité de substitution – qui se présente, et elle laisse à la serveuse ce prénom dont elle veut se débarrasser, « Diane ».
L’échange de prénoms est aussi un moyen de séparer la morte de la vivante. Diane Selwyn est une sorte de morte-vivante, une morte en sursis : pour que son visage continue de porter la vie, il faut que soit mis à distance le nom de Diane, qui porte la mort. Betty et Rita vont donc retrouver la trace d’une Diane Selwyn, à Sierra Bonita, qui va s’avérer être une morte, mais heureusement pour Diane et pour son rêve, cette Diane Selwyn est défigurée donc non-identifiable. Diane se représente en somme sa propre mort, la mort à laquelle au fond, quand elle ne rêve pas, elle se sait condamnée, mais avec ce voile d’ignorance qui permet de ne pas se reconnaître, et donc de dormir et rêver en paix.
Ce travail de déplacement est lui-même signalé métaphoriquement dans le rêve, par un véritable déplacement, dans l’espace : en même temps qu’elle abandonne le nom de Diane pour celui de Betty, l’héroïne déserte Sierra Bonita pour aller vivre dans les beaux quartiers, à Havenhurst. La coupable retrouve son innocence, la morte en sursis reprend goût à la vie, la pauvre devient riche.
Par ces opérations de déplacement, le rêve permet à Diane de s’aimer elle-même et d’aimer l’autre pleinement, sans que ces amours soient parasités par la haine. Tout se passe comme si la rêveuse pouvait se dire : je hais Diane Selwyn, la meurtrière, mais Diane Selwyn ce n’est plus moi, c’est une inconnue dont le visage a été défiguré (et moi je suis Betty). Et je hais Camilla Rhodes, la voleuse de rôle, la femme d’Adam Kesher, mais Camilla Rhodes ce n’est plus toi, la femme brune que j’aime : c’est une blonde que je n’aime pas (toi, tu as oublié ton nom et je t’appelle Rita). L’édifice est certes fragile : pour que ces déplacements fonctionnent, il faut que Diane Selwyn soit défigurée (donc sans visage) et que Camilla soit amnésique (donc sans nom). Mais par ce travail de mise à distance de tout ce qui est insupportable, le rêve est bien ce qui, comme un film, permet de rester soi-même tout en devenant autre. Un pouvoir qui est d’ailleurs rappelé par Betty lorsque, pour convaincre Rita de partir à l’aventure avec elle, elle lui lance : « Allez ! Ce sera comme dans les films : on dira qu’on est quelqu’un d’autre ! ».
« merci pour tout »
Après avoir fait revenir Camilla dans le monde des vivants, après s’être débarrassée du fardeau de souffrance et de culpabilité dont Diane Selwyn est le nom, les choses sérieuses peuvent commencer. Les conditions sont réunies pour que l’histoire d’amour ait lieu, sous la forme idéalisée qui convient à l’imaginaire hollywoodien de Diane – loin des frustrations, des dépendances et des blessures narcissiques qui ont jalonné sa véritable relation avec Camilla. Les correspondances entre le rêve et la réalité vont alors obéir à une logique simple : tout se rejoue à l’envers. Diane était malheureuse, Betty sera radieuse. Diane était passive, reléguée à une place de spectatrice impuissante (du baiser d’Adam et Camilla notamment, puis de l’annonce de leur mariage), Betty sera au contraire l’élément actif, dynamique, entreprenant du couple qu’elle forme avec Rita. C’est elle qui insistera pour mener l’enquête sur « l’accident qui a eu lieu à Mulholland Drive », et pour téléphoner à la police puis à la mystérieuse Diane Selwyn dont se souvient Rita. C’est elle encore qui osera sonner chez la voisine de cette Diane Selwyn, c’est elle qui prendra l’initiative d’entrer par la fenêtre, puis de couper les cheveux de Rita, et enfin de l’inviter à dormir dans son lit. Camilla de son côté nous est montrée dans le souvenir de Diane comme une femme toujours sûre d’elle et de son charme, souveraine, dominatrice voire manipulatrice, et Rita au contraire va apparaître comme une femme perdue, et même comme une bête apeurée, littéralement diminuée par l’accident dont elle a réchappé : passive, amnésique, hébétée, elle a besoin de Betty pour la recueillir, la soigner, la cajoler.
C’est cette inversion de la relation de dépendance qui constitue la véritable revanche de Diane. La détresse que Camilla lui a fait vivre dans la réalité, elle la lui inflige à son tour dans le rêve – à ceci près que, revanche ultime, elle se montre magnanime et lui accorde une compassion que Camilla lui avait refusée. Là où Camilla a représenté – à ses yeux en tout cas – la force sans la pitié, la puissance de séduction insensible aux ravages qu’elle peut causer, Diane choisit d’incarner la force tempérée par la compassion – et sublimée par le véritable amour. Camilla a laissé le piège de Mulholland Drive se refermer implacablement sur Diane : le rêve fait revivre à Rita la même arrivée angoissante sur les mêmes lieux, mais en introduisant un deus ex machina – l’accident de voiture – qui la sauve au dernier moment. Camilla est partie avec Adam Kesher, laissant Diane seule avec sa souffrance : Betty offre à Rita un toit, une couverture, une amitié puis un authentique amour.
Rita de son côté ne sort de sa torpeur que pour manifester sa reconnaissance puis son amour : lorsqu’elle se réveille de sa sieste, elle demande pardon pour son intrusion dans la maison de Tante Ruth – et pour Diane cette demande sonne comme un triomphe : cette femme qui l’a fait tant souffrir présente des excuses [6]. L’ingratitude et la cruauté que Diane reproche à Camilla sont d’ailleurs rachetées une seconde fois lors de la nuit d’amour, lorsque Rita dit à Betty ce que sans doute Camilla n’a jamais dit à Diane : « Merci pour tout ».
« silencio »
L’extrême douceur de la nuit d’amour est aussi le produit d’un réagencement : si l’on en juge à la seule scène érotique réelle qui nous est donnée à voir, à savoir la scène de la rupture sur le canapé, la relation qu’ont vécue dans la réalité Diane et Camilla a été beaucoup plus dure et froide. Et si Betty répète à deux reprises « je suis amoureuse de toi », sans doute est-ce parce que ces paroles ont manqué dans la réalité : dans le souvenir de Diane, Camilla se contente de dire « tu me rends folle », ce qui n’est pas du tout le même registre. Cette dernière hypothèse expliquerait pourquoi la transition entre le rêve idyllique et la triste réalité se passe dans un lieu qui se nomme Silencio : le drame de Diane est fondamentalement un problème de parole et de silence.
L’enjeu se précise plus encore lorsqu’on prête attention à la chanson interprétée par Camilla Rhodes lors de son audition, I told every little star : « J’ai dit à toutes les étoiles combien je te trouve adorable, pourquoi ne te l’ai-je pas dit à toi ? » (« I told every little star just how sweet I think you are, why haven’t I told you ? »). En rêvant qu’une femme nommée Camilla Rhodes chante ces mots en sa présence, Diane peut s’imaginer que c’est la vraie Camilla – donc l’être aimé – qui lui parle. Et qu’elle lui dit en substance ceci : si je n’ai jamais rien verbalisé, c’est seulement par timidité, mais au fond de moi je t’ai aimée. Les paroles de la chanson permettent aussi à Diane de transfigurer une liaison clandestine, « placardisée » (on le devine à la soirée d’Adam Kesher, puisque Diane se contente d’évoquer une « amitié » avec Camilla), en relation amoureuse assumée au grand jour, puisque révélée à toutes les étoiles – autrement dit : à toutes les stars, à tout le Gotha hollywoodien.
La chanson se conclut par un retournement : « Peut-être que toi aussi tu le sais, mais si c’est le cas pourquoi ne le dis-tu pas ? » (« Maybe you may know it too, oh my darling if you do, why haven’t you told me ? »). Et de fait, c’est précisément lorsqu’elle entend ces paroles que Betty semble prendre conscience de son amour et de la nécessité de le verbaliser : suivant le conseil de la chanson, elle court retrouver Rita et enfin lui dire ce qui paraît, dans la réalité, n’avoir été jamais dit.
Il y a donc une parole manquante, mais il y a aussi une parole en trop : le fameux « c’est elle », cette sentence de mort prononcée en montrant au tueur la photo de Camilla. De ce point de vue, le nom Silencio donné au théâtre où tout s’achève peut aussi être entendu comme une expression du regret de Diane : le regret d’avoir proféré cette phrase de trop. Ces paroles manquantes ou en trop peuvent expliquer d’ailleurs la manière singulière dont Diane se tue (et dont, avant cela, elle prémédite en rêve sa propre mise à mort) : pour n’avoir jamais dit ce qu’elle devait dire (la déclaration : « je suis amoureuse de toi ») et pour avoir dit ce qu’il ne fallait surtout pas dire (la sentence de mort : « c’est elle »), Diane se punit par où elle a péché, en se tirant une balle dans la bouche.
« arrête de faire le malin »
Pour que la revanche de Diane soit complète, il ne faut pas seulement réécrire l’histoire avec Camilla mais aussi se venger d’Adam Kesher et d’Hollywood, l’individu et le système qui lui ont pris ses rêves d’enfant (devenir star) et l’objet de son amour (Camilla). L’opération est ici plus simple : pour Adam Kesher et ses collègues d’Hollywood, Diane n’éprouve que du ressentiment. Il suffit donc de rendre coup pour coup, comme dans un revenge movie – et c’est précisément en puisant dans son imaginaire de cinéphile que Diane va trouver sa vengeance, en inventant trois personnages, ou plutôt en les reproduisant, en faisant revenir trois archétypes hollywoodiens : un cowboy sorti de chez Clint Eastwood ou Sergio Leone, un Parrain sorti de chez Coppola, et un « homme de la rue » dans la veine des films de Frank Capra.
« Le cowboy » fait partie de ces personnages dont Diane ne connaît pas l’identité mais qui, en une seule rencontre, l’ont marquée à vie. La raison en est simple. D’abord parce qu’on n’oublie pas, dans une fête, un invité habillé en cowboy. Ensuite parce que ledit cowboy passe dans le champ de vision de Diane au moment précis où elle est en train de subir sa pire humiliation : Adam Kesher, hilare, annonce son mariage avec Camilla, tandis que celle-ci se laisse embrasser nonchalamment par une inconnue. C’est donc au moment même où se commet l’offense qu’un homme étrange habillé en cowboy passe devant elle – un de ces énergumènes comme on en croise dans les soirées hollywoodiennes (dans La Party de Blake Edwards, par exemple, à laquelle Lynch a peut-être bien pensé). Qu’à cela ne tienne : il sera le justicier.
Quoi de mieux en effet, pour cette fonction, qu’un cowboy solitaire ? Car ce cowboy est bien solitaire : il a certes été invité à la fête d’Adam Kesher mais il se tient à l’écart, il ne fait que passer à l’arrière-plan, sans se joindre au petit cercle de courtisans qui s’est formé autour de la star et du réalisateur en vogue pour assister au spectacle mondain de l’annonce du mariage. Cette distance fait de lui un allié possible dans la guerre que Diane a déclarée au « monde merveilleux d’Hollywood ». Son rôle sera donc d’humilier Adam Kesher et de le remettre à sa place. Impassible, glacial et sentencieux comme un Clint Eastwood de série B, ou comme Henri Fonda chez Sergio Leone, il pourra lui dire enfin ce que Diane aurait tant aimé lui dire à Mulholland Drive : arrête de faire le malin ! Le dialogue complet mérite d’être retranscrit :
« — L’attitude d’un homme détermine en quelque sorte la tournure que va prendre sa vie. Est-ce que tu serais d’accord avec ça ?
— Oui.
— Est-ce que tu me réponds ça parce que tu penses que ça me fait plaisir de l’entendre ou parce que tu es vraiment d’accord ?
— Je suis d’accord avec ce que tu as dit, vraiment.
— Qu’est-ce que j’ai dit ?
— Que l’attitude d’un homme détermine dans une large mesure ce que sera sa vie.
— Donc puisque tu es d’accord, tu dois être le genre de personne qui ne se soucie pas tellement de la belle vie.
— Comment ça ?
— Eh bien arrête-toi deux secondes et réfléchis. Tu peux faire ça pour moi ?
— Ok, je réfléchis !
— Non, tu ne réfléchis pas. Tu es trop occupé à faire le malin. Alors je te demande d’arrêter de faire le malin, et de réfléchir. Tu peux faire ça pour moi ? »
« ce n’est plus ton film »
À Mulholland Drive toujours, lorsqu’Adam annonce son mariage avec Camilla, Diane est assise en face d’un homme d’un certain âge, plutôt taciturne, qui boit son café sans rien dire. Sa réserve le distingue des poses séductrices de Camilla et du cabotinage d’Adam, mais aussi des courtisans ébahis qui se pressent autour d’eux : il sera lui aussi du côté des vengeurs. Et comme Diane entend alors une voix prononcer le prénom Luigi, une panoplie de vengeur est toute trouvée pour ce voisin de table ordinaire qui n’a pas la dégaine d’un cowboy. Il sera Luigi Castigliane, proche cousin du Don Corleone de Coppola – un personnage que Diane connaît forcément, puisque le travail onirique qui s’opère dans son Inconscient rejoue à l’identique la séquence d’ouverture du Parrain : Don Corleone recevant la visite d’un honnête homme d’affaires qui déclare avoir « cru en l’Amérique » mais avoir été déçu, notamment par la justice américaine, coupable de n’avoir pas condamné assez durement l’homme qui a défiguré sa fille. La Mafia est en somme introduite dans le film de Coppola comme le recours, la seconde chance, la justice de substitution vers laquelle on se tourne lorsque justice ne nous a pas été rendue par le système. Et tel est aussi, justement, le rôle que va jouer la Mafia dans le rêve de Diane. Car Diane aussi peut s’estimer trompée par le rêve américain – et plus précisément, dans son cas, par le rêve hollywoodien. Diane aussi peut se considérer comme la victime d’une violence impunie : sa carrière avortée, mais aussi le départ de Camilla et son mariage avec Adam Kesher – un homme qui lui aussi, d’une certaine manière, a défiguré un être cher, en faisant de Camilla une caricature de vamp hollywoodienne. Diane aussi, par conséquent, n’a plus que la Mafia pour lui rendre justice et restaurer son honneur.
La vengeance se réalise tout d’abord par l’humiliation que constitue, tant pour l’individu Adam Kesher que pour le système Hollywood, l’imposition d’une débutante comme premier rôle – et là encore le motif est directement emprunté au Parrain de Coppola, où l’on voit Don Corleone imposer un de ses protégés dans un premier rôle que lui refuse un producteur hollywoodien. Comme Adam Kesher dans le rêve de Diane, le producteur commence par résister, en clamant que le protégé de la Mafia ne jouera « jamais » dans son film, avant de se raviser. Pareillement, Adam Kesher commence par prendre la pose de l’artiste rebelle, mais la réponse de Luigi Castigliane est implacable :
« Cette fille ne jouera pas dans mon film !
— Ce n’est plus ton film. »
Pour le remettre définitivement à sa place, la Mafia enverra le cowboy dire au cinéaste de ne plus faire le malin, après l’avoir dépossédé de tous ses attributs virils – tout ce qui a pu séduire Camilla, tout ce au nom de quoi, dans la réalité, il s’est autorisé à faire le malin : son statut de metteur en scène (réduit à néant par l’interruption du tournage) et son compte en banque (bloqué). Il peut certes sembler étrange de considérer la Mafia comme une alliée : elle cause un tort immense à Betty, en imposant à Adam Kesher la débutante Camilla Rhodes pour le rôle de Sylvia North alors que le jeune réalisateur, manifestement impressionné par Betty dès le premier regard, semble prêt à la retenir. Mais il ne faut pas s’y tromper : en causant ce tort à Betty, la Mafia rend un service inestimable à Diane. Elle lui permet de sauver la face et de recouvrer l’estime d’elle-même, en lui offrant une raison honorable d’avoir été recalée : si le rôle de Sylvia North lui échappe à cause d’une pression de la Mafia, son talent d’actrice n’est plus en cause.
« oublie ce que tu as vu »
Avec enfin le personnage, éminemment sympathique, de Gene Clean (« Gene le Nettoyeur »), la vengeance s’accomplit suivant une stricte application de la loi du talion. Adam Kesher est puni par là où il a fauté : en couchant avec Lorraine, la femme du cinéaste, Gene Clean ne lui inflige rien d’autre que ce que ledit cinéaste a fait à Diane dans la réalité (en séduisant Camilla). Tu as pris la femme d’une autre, un autre va te prendre la tienne. Le scénario, il est vrai, n’est pas une pure invention de Diane : contrairement au personnage de Luigi Castigliane, produit presque intégralement par le travail onirique, et à celui du cowboy, extrapolé à partir d’une simple tenue vestimentaire, le personnage de Gene Clean est construit à partir d’une personne réelle, évoquée par Adam lors de la fête de Mulholland Drive. Il y a bien eu dans la réalité un nettoyeur de piscine, et il y a bien eu une liaison entre ce nettoyeur et la femme du cinéaste. Les déplacements opérés par le travail onirique sont donc plus subtils : c’est la tonalité générale de l’histoire qui est modifiée.
Ce qu’a été dans la réalité cette histoire d’adultère nous demeure inconnu, mais deux versions nous sont proposées : l’une est un souvenir de Diane, le souvenir d’un récit d’Adam Kesher, donc d’une version officielle, possiblement enjolivée par le cinéaste, et l’autre est une réécriture libre produite par Diane en train de rêver. La version d’Adam est un vaudeville qui finit bien pour le mari trompé : « Le juge m’a donné la maison et la piscine, et il lui a laissé le nettoyeur ! J’avais envie de lui offrir une Rolls-Royce ! Il y a des jours où tout vous sourit ! ». La version de Diane est aussi un vaudeville, mais amputé du happy end et augmenté de certains épisodes cocasses permettant de ridiculiser celui qui, devant ses convives, trouve jusque dans ses déboires conjugaux une occasion de remercier le destin et, redisons-le, de faire le malin. Ce sont donc des poncifs du vaudeville qui sont rajoutés par Diane, en particulier une scène de ménage au cours de laquelle le mari trompé se ridiculise. Tout ce que l’expérience d’Adam a pu avoir d’humiliant, de blessant, de douloureux, et qu’il a soigneusement éliminé de son récit, Diane le ramène sur le devant de la scène : le mari surprend sa femme au lit avec Gene Clean, saccage les bijoux de l’infidèle à coups de peinture rose et finit tabassé par l’amant – et c’est ainsi qu’à la conclusion enjouée « Il y a des jours où tout vous sourit » répond, dans le rêve de Diane, cette confidence désenchantée que le cinéaste abattu lâche à sa secrétaire : « Il y a des jours comme ça… ».
Diane n’invente pas non plus le statut social subalterne de cet amant qui a bien été, dans la réalité, un nettoyeur de piscine, mais là encore elle modifie la perspective, en prenant le parti des dominés. Là où Adam Kesher affiche tranquillement son mépris social à l’encontre de son employé, et exhibe sans retenue ses signes extérieurs de richesse (la maison, la piscine, la Rolls-Royce), le rêve de Diane répond d’une part en faisant d’Adam un homme ruiné, dont les comptes en banque ont tous été bloqués, d’autre part en retournant le stigmate : Gene Clean devient une figure positive, celle de l’homme du peuple, simple et sain. Si la piscine peut figurer facilement, par métonymie, l’appartenance de classe d’Adam Kesher, la profession de Gene Clean elle aussi devient tout un symbole : « Gene le nettoyeur » est quelqu’un de propre, et il est un alter ego de Diane, un frère de classe. Comme elle, et comme sa tante Ruth, il travaille à Hollywood (au pays des piscines) mais à une place subordonnée (dans le nettoyage).
Mais Gene n’est pas seulement un « héros de la classe ouvrière » : il est aussi un sage. Sa barbe est celle d’un Bee Gees mais aussi celle d’un Socrate. Comme l’archétype du sage, Gene parle peu et bien, et la réalité ne le prend jamais en défaut. Même dans la plus inconfortable des situations, lorsqu’Adam le surprend au lit avec sa femme, Gene réagit avec un flegme admirable, qui rend l’épisode d’autant plus comique pour le spectateur – et humiliant pour le mari trompé. Sans esquisser le moindre geste de fuite, Gene reste impassible, les bras croisés, et se contente d’un conseil adressé amicalement au malheureux cinéaste, qui semble frappé au coin du bon sens : « Oublie ce que tu viens de voir, c’est mieux pour toi ». Il faudra qu’Adam et sa femme partent se battre dans une pièce voisine pour que Gene daigne finalement se lever et agir, avec le même flegme, la même économie de moyens et la même efficacité : tandis qu’Adam gesticule dans tous les sens, Gene se contente d’un unique coup de poing bien cadré, qui suffit à mettre le cinéaste à terre. Pour ponctuer le geste en beauté, il ne manque plus qu’une ultime sentence, toujours aussi laconique et frappée du sceau de l’évidence : « Ce n’est pas une façon de traiter ta femme, même après ce qu’elle t’a fait ».
Si Diane se figure ainsi le personnage de Gene Clean, si elle en fait ce sage à qui rien ne manque, ni la rareté et la justesse du verbe, ni la sobriété et l’à-propos du geste, ni la barbe, c’est sans doute parce qu’au maniérisme et aux simagrées de la gent hollywoodienne, elle a besoin d’opposer une figure de la « sagesse populaire ». Le contraste est en effet saisissant entre la sobriété et le laconisme de Gene – son cool – et les gesticulations hystériques du servile Vincent Darby, de l’obséquieux Wally Brown, du prétentieux Bob Brooker, du libidineux Woody Katz, de la condescendante Coco et bien entendu du poseur Adam Kesher.
« si vous voulez, je vous présenterai »
La revanche sociale est rejouée enfin sur un autre mode, moins vertueux. Diane est issue de la petite bourgeoisie, elle habite un modeste deux-pièces à Sierra Bonita, et elle se sent comme une intruse dans l’immense villa où la reçoit Adam Kesher, entouré de sa mère Coco et de sa nouvelle fiancée Camilla. Betty se retrouve au contraire locataire légitime d’un luxueux appartement à Havenhurst, et c’est Camilla qui, dans ce luxueux « endroit de rêve », devient l’intruse. Quant à la froide et condescendante Madame Kesher, surnommée Coco, son déplacement onirique est aussi un déclassement puisque, tout en gardant le même visage, le même accoutrement et le même surnom, elle devient Madame Lenoix [7], la concierge exubérante mais serviable et chaleureuse qui accueille Betty et, dès son arrivée, lui propose de lui présenter les autres locataires.
La revanche est encore plus radicale, brutale, impitoyable dans une autre séquence onirique, qui n’a aucune utilité dramaturgique et ne remplit qu’une seule, unique et primaire fonction : rendre coup pour coup, voire rendre au centuple. Coco a pris Diane de haut, Diane rabaisse Coco dans son rêve en introduisant un locataire négligeant, Wilkins, qui a laissé son chien déféquer dans la jolie cour intérieure de Havenhurst. Le film ne nous montre qu’un gros plan des étrons, puis la colère de Coco, qui sait que c’est bien à elle, la concierge, qu’il reviendra de les ramasser. Tout se passe en somme comme si Diane disait à la vieille dame : tu m’as prise pour de la merde, maintenant tu ramasses ma merde. Au mépris de classe de la grande dame d’Hollywood pour la petite-bourgeoise provinciale répond un autre mépris de classe : celui de la petite-bourgeoise pour la prolétaire.
« hollywood »
En plan fixe et à deux reprises dans le film, un panneau « Hollywood » vient s’inscrire au centre de l’écran comme un rappel : au-delà de tous les acteurs humains qui s’agitent sous nos yeux, au-delà de l’individu Adam Kesher, finalement pathétique, un peu frimeur mais pas vraiment détestable [8], il existe une puissance tutélaire véritablement maléfique, une matrice, un système dont le nom est donc Hollywood. Et ce sont en fait tous les cadres d’Hollywood, tous ceux qui à Hollywood exercent un certain pouvoir, qui renvoient une image exécrable. L’audition de Betty nous donne à voir toute une brochette de pseudo-artistes aussi précieux que ridicules – en particulier le réalisateur Bob Brooker avec son air inspiré et ses conseils abscons (« Ne le joue pas pour de vrai avant que ça ne le devienne »), l’acteur Woody Katz, bellâtre vieillissant et libidineux, et Wally Brown, le gesticulant « Monsieur Loyal » qui dirige l’audition. Sans oublier les producteurs Vincent Darby et Robert Smith, qui sont figurés par la rêveuse comme des pantins serviles, obséquieux, humiliés par Luigi Castigliane. Ce dernier va jusqu’à cracher le café qui lui est offert, en grommelant que « c’est de la merde », réalisant ainsi ce que la bienséance hollywoodienne a empêché Diane de faire à Mulholland Drive, alors qu’elle en mourait d’envie : oublier qu’elle n’est pas chez elle et cracher le café qu’elle est en train de boire au moment précis où le cinéaste se pavane et annonce fièrement son mariage. Et, au-delà de ce café, cracher sa haine et son dégoût pour Camilla qui la nargue, Adam qui « fait le malin » en exhibant sa fiancée comme un trophée, Coco qui lui rappelle lourdement son statut de subalterne à Hollywood – bref : tout ce microcosme « de merde » en permanente représentation.
Pourquoi tant de haine contre Hollywood ? De quoi exactement faut-il se venger ? D’abord de l’Idéal du moi hollywoodien, qui est à l’origine de toutes les incapacités de Diane et de tous ses refoulements. L’idéal de la femme comme il faut, d’abord, jeune et jolie, qui sait se tenir dans les fêtes, s’excuser pour son retard et surtout ne pas cracher son café – et encore moins sa haine – même quand on la méprise, même quand on l’humilie, même quand on se fout d’elle, même quand elle souffre. L’idéal de l’amour pur et sans mélange, ensuite, qui ne saurait s’accompagner de jalousie, de rivalité ou de ressentiment – cet « amour éternel et sans divorce » qui est censé durer toujours, comme dans la chanson Sixteen reasons why I love you qu’on entend lors de l’audition d’Adam Kesher (« You say we’ll never part, our love’s complete »). Ce sont ces clichés d’amour hollywoodiens qui ont rendu Diane aussi romantique, aussi inapte à supporter la déception, l’humiliation, la séparation – et surtout la coexistence en une seule et même personne (nommée Camilla) de l’aimée et de la rivale. Comme le confie Minnie dans le Minnie et Moskowitz de John Cassavetes, après avoir vu au cinéma Casablanca, avec Bogart : « Les films sont vraiment une conspiration, parce qu’ils vous piègent, dès que vous êtes gosse. Ils vous forcent à croire à des idéaux, à la force d’âme, aux types bien, à la romance et bien sûr à l’amour. Même si vous êtes intelligents » [9].
Mais il y a pire : en même temps qu’il façonne cet Idéal du moi tyrannique, Hollywood reproduit un ordre social qui empêche objectivement tout accomplissement de cet idéal. En même temps qu’il impose des idéaux d’amour pur et sans mélange, il perpétue une domination masculine, organise une féroce compétition entre les femmes, et sape donc, entre femmes autant qu’entre hommes et femmes, toute possibilité de vie amoureuse ou amicale. En même temps qu’Hollywood professe l’amour éternel, il ravit Camilla à Diane, en la soumettant à la loi implacable qui veut qu’une star se marie avec un réalisateur en vogue. Hollywood est en somme coupable de susciter des désirs, des exigences, des idéaux auxquels la réalité ne peut tout simplement pas apporter de satisfaction.
Ce dont il faut se venger, c’est donc aussi du principe de réalité hollywoodien : cette dure loi des auditions qui veut qu’une multitude de jeunes filles, plus talentueuses et belles les unes que les autres, soient recalées et renvoyées à l’anonymat – ou, comme Diane, cantonnées aux seconds rôles parce qu’un Bob Brooker ne les a « pas trouvées bonnes ». Sur ce point comme sur les autres, le rêve se charge d’assurer la revanche du principe de plaisir en renversant le rapport de pouvoir : à la place d’une multitude de prétendantes pour un seul rôle, il y aura deux tournages, donc deux équipes, chacune éblouie par une actrice unique et se la disputant – l’équipe du directeur de casting Wally Brown d’une part, qui auditionne dans une minuscule pièce pour un film sans titre de Bob Brooker, et d’autre part une directrice de casting plus en vue, Linney James, qui oriente Betty vers un réalisateur plus côté, Adam Kesher, en train d’auditionner, sur un immense plateau, pour L’histoire de Sylvia North.
Cette inversion est rendue possible par un travail de déplacement, à nouveau, qui aboutit à un dédoublement. L’histoire de Sylvia North, le film de Bob Brooker évoqué par Diane à la fête d’Adam Kesher, se divise en deux films : le travail onirique introduit subtilement un autre film de Bob Brooker, ou plutôt un projet de film sans titre (une espèce de mélodrame sur la liaison entre une jeune femme et le meilleur ami de son père), et fait de L’histoire de Sylvia North un film dont l’auteur n’est pas Bob Brooker (mais Adam Kesher). C’est ce dédoublement qui permet à Diane de se figurer des réalisateurs et des agents de casting en situation de concurrence – autrement dit : de leur infliger ce qu’eux-mêmes lui ont infligé, et qu’à toutes les actrices en permanence ils infligent. Betty se retrouve dès lors au centre de tout, elle devient l’élément désiré, convoité de tous, alors que Diane n’a été que désirante. Et si le film de Bob Brooker ne se tourne finalement pas avec elle, c’est de son fait : elle doit viser plus haut que ce projet pourri, dont le scénario est ridicule (elle le déclare elle-même à Rita) et dont le réalisateur est un has been (Linney James le lui confie). Cette inversion de la relation désirant/désiré entre Diane et Hollywood se rejoue d’ailleurs sur le plan amoureux dès la séquence suivante : alors que dans la réalité, Camilla a quitté Diane pour rejoindre Adam Kesher, le rêve replace Betty au centre du jeu puisqu’Adam Kesher semble tomber amoureux de Betty en un simple regard, mais qu’avec précipitation Betty quitte le plateau (et donc Adam) pour rejoindre Rita.
« c’est elle ! »
Hollywood comme vecteur de violence, comme puissance de mort, c’est aussi ce que fait apparaître l’un des principaux leitmotivs du film : « C’est elle ». Ces mots qui ont été une sentence de mort prononcée par Diane – accompagnant une photo de Camilla montrée au tueur – sont eux aussi repris dans le rêve, mais avec un déplacement, ou plutôt plusieurs déplacements. S’ils accompagnent toujours une photo de « Camilla Rhodes », ladite Camilla Rhodes n’est plus la femme brune aimée (mais une blonde détestée), la sentence n’est plus prononcée par Diane (mais par le chef de la Mafia, puis le réalisateur Adam Kesher), et ce n’est plus une sentence de mort (mais une élection : celle de l’actrice engagée pour le premier rôle). Il n’y a là rien d’anodin : il ne va pas de soi d’associer la désignation d’une actrice à une mise à mort. Cela peut toutefois s’expliquer, de plusieurs manières. Il est vrai d’abord qu’en un sens Camilla a bien signé son arrêt de mort le jour où elle a été choisie pour le rôle de Sylvia North, le jour donc où Bob Brooker a dû prononcer cette sentence : « C’est elle ». C’est bien ce rôle convoité par Diane et décroché par Camilla qui est à l’origine de tout le drame : une carrière d’actrice avortée pour Diane, une relation amoureuse dissymétrique avec Camilla, parasitée par la rancœur et marquée par la dépendance, la fin douloureuse de cette relation et les folles représailles de Diane. Mais une autre interprétation est possible, plus simple, qui consiste à dire que, de toute façon, toute audition est une mise à mort : une seule prétendante est sauvée, toutes les autres sont éliminées.
L’histoire à laquelle nous avons assisté est en somme une très banale histoire, typiquement et sordidement hollywoodienne, de vengeance, qui par ailleurs se passe à Hollywood : une actrice de second rang fait assassiner sa rivale, qui fut aussi son amante. Mais la place marginale que le film accorde à cette histoire (les vingt dernières minutes), et le dénouement tragique qu’il lui apporte (le suicide de Diane), sont là pour nous montrer que ce type de vengeance est sans issue et ne venge rien. Si Gene Clean est un sage, c’est d’ailleurs aussi pour nous dispenser cette leçon. Comme Adam Kesher a besoin du cowboy pour lui dire de ne plus faire le malin, Diane a besoin de Gene pour lui dire, amicalement mais fermement, avec franchise, ses quatre vérités. Comme par ailleurs cette vérité a quelque chose d’insupportable, il faut là encore un déplacement : c’est Adam qui se substitue à Diane pour entendre la parole vraie du sage, ou plutôt ses deux paroles vraies : d’abord « Oublie ce que tu as vu, c’est mieux pour toi », et ensuite « Ce n’est pas une façon de traiter ta femme, même après ce qu’elle t’a fait ». Deux phrases qui signifient d’abord : Adam, oublie que tu viens de me voir dans ton lit avec Lorraine, c’est mieux pour toi, et ne lui tape pas dessus, même si elle t’a trompé. Mais qui deviennent, si on les adresse à Diane plutôt qu’à Adam, bien plus lourdes de sens, de vérité et de gravité, puisqu’elles disent alors ceci : Diane, tu aurais mieux fait d’oublier ce que tu as vu (Camilla te narguer en embrassant sous tes yeux Adam Kesher, puis une inconnue blonde), et tu n’aurais pas dû tuer « ta femme », Camilla, même après tout le mal qu’elle t’a fait. L’oubli et le pardon en somme, ou du moins l’indulgence, valent mieux que la vengeance pour ce qui concerne l’être aimé, même quand il a déçu. La bonne revanche passe par d’autres voies, ciblant non pas une « amante inconstante » (Camilla) ni même un « insolent vainqueur » (Adam) mais tout un système. Cette bonne revanche, c’est le rêve de Diane qui l’aura accomplie, hélas trop tard, mais tel est en tout cas, me semble-t-il, le dernier mot de Mulholland Drive : pour bien se venger à Hollywood, c’est d’Hollywood qu’il faut se venger.
épilogue
« 7 bis rue du Nadir aux Pommes »
Juliet Berto est Céline Cendrars, magicienne de profession. Elle exerce son art dans un cabaret montmartrois miteux devant un public masculin qui ne vient « que pour son cul », comme elle dit, sous la coupe d’un impresario paternaliste qui la voit « pleine de pétulance et d’avenir » et lui promet « une tournée internationale ». Dominique Labourier est Julie, bibliothécaire, sur le point de retrouver Grégoire, dit Guilou, son « fiancé d’enfance » – qui revient, tout fier d’être « devenu un homme », avec l’objectif de lui « passer la robe blanche ». Barbet Schroeder, Bulle Ogier et Marie-France Pisier sont Olivier, Camille et Sophie, les sinistres locataires d’une grande et vieille demeure. Tournée en 1974 et intitulée Céline et Julie vont en bateau, leur histoire est une première version, optimiste, comique et psychédélique, de Mulholland Drive. Exactement comme dans le film de Lynch, une femme brune déboule les genoux en sang dans l’appartement d’une autre, aux cheveux plus clairs, y prend une douche, s’y installe, séduit l’hôte des lieux et part avec elle, en taxi, à la recherche d’un passé enfoui – avec comme seul point de départ des bribes de souvenirs dont celui d’une adresse : non pas Mulholland Drive, mais le 7 bis de la rue du Nadir aux Pommes.
Au-delà de bien d’autres points communs, comme les scènes de voyance et de magie, les déguisements et les perruques, les échanges d’identité, la satire des producteurs de spectacle et des impresarios, la stigmatisation des piscines et des coupes de champagne comme signes extérieurs de richesse, les maisons morbides dans lesquelles on entre ou sort par les fenêtres, les sacs à main d’où sortent par miracle des mystérieux petits objets colorés (une clef bleue, un bonbon vert), le film de Berto, Rivette & Co [10] et celui de David Lynch ont en commun surtout d’opposer, chacun à sa manière, deux univers diamétralement opposés, l’un réel et l’autre onirique, fantasmatique ou en tout cas « irréel », assimilé explicitement au cinéma – à cette différence près que c’est le sommeil et le rêve qui projettent l’héroïne lynchienne dans « l’autre monde », alors que le trip de Céline et Julie passe par l’ingurgitation d’un mystérieux petit bonbon vert.
Mais là n’est pas l’essentiel. Ce qui distingue les deux films, et fait même de l’un l’envers de l’autre, c’est que Lynch oppose en dernière instance le « monde de rêve » des films hollywoodiens à une réalité sordide qu’il dissimule et travestit, alors que Rivette et ses co-auteures nous donnent à voir ledit « monde de rêve » comme un véritable cauchemar : un univers bourgeois et affecté (« C’est robes de soirée, piano et coupes de champagne ! », vanne Céline), un microcosme confiné et asphyxiant, imposant à ses personnages une gestuelle chichiteuse et empesée (« Ils sentent un peu la naphtaline », dixit Céline, toujours), une langue et une diction compassées (« ils parlent curieux ») et une existence répétitive (« ils permanentent », « ils perpétuent », « ils se font la journée perpétuelle »), s’opposant à une vraie vie beaucoup plus ouverte à l’invention, à la déconnade, au plaisir et – surtout – à la complicité entre femmes.
Car c’est bien là ce qui fait de Céline et Julie un objet unique, et pas seulement si on le compare au film de Lynch. Là où le cinéaste américain ne nous montre – pour la dénoncer – qu’une réalité brutale, qui place les femmes en compétition les unes avec les autres, dans des rôles sociaux stéréotypés, étouffants et mortifères, et un cinéma hollywoodien menteur par omission, coupable donc de n’offrir aux jeunes spectatrices que des rêves d’amour trop beaux pour être vrais, le film de Berto, Rivette & Co va plus loin dans la critique féministe en soulignant, par le biais d’une maison poussiéreuse hantée par des personnages blafards, guindés et lugubres, tout ce que le « rêve » du grand répertoire théâtral et cinématographique peut avoir en lui-même de profondément cauchemardesque aux yeux de deux spectatrices averties, joyeuses et unies – et plus précisément joyeuses et averties parce qu’unies.
On ne peut pas en effet assister à ce retournement – une réalité plus joyeuse que la fiction, des femmes plus unies en vrai qu’en rêve – sans penser à ce que Delphine Seyrig suggère dans son documentaire Sois belle et tais-toi, et que confirment toutes les actrices qu’elle interroge, de Shirley MacLaine à Jane Fonda et de Maria Schneider à, justement, Juliet Berto : le tabou sexiste le plus scrupuleusement respecté dans le cinéma français comme dans le cinéma hollywoodien n’est pas la hiérarchie premier rôle masculin/second rôle féminin, ni l’assignation des femmes à des fonctions caricaturalement « féminines » (épouse, maman, putain ou petite chose sensible et sans défense), mais l’interdit de la complicité entre femmes – alors qu’on ne compte plus les amitiés sublimes entre hommes, de Jules et Jim à Butch Cassidy et le Kid. Quand d’aventure les actrices ont des rôles de premier plan, elles sont quasi-systématiquement – « sauf dans Céline et Julie évidemment », comme le fait remarquer Delphine Seyrig – isolées ou divisées : soit que le scénario leur réserve l’unique rôle féminin dans une histoire d’hommes, soit qu’il les sépare des autres femmes en ne montrant chacune qu’en interaction avec un ou plusieurs hommes, soit enfin qu’il les rassemble dans une même scène mais pour ne montrer qu’une rivalité, une haine et un « crêpage de chignon » – dont l’objet est en général, tout naturellement, l’attention d’un homme qu’elles se disputent.
C’est bien tout cela qu’à l’évidence nous montre Mulholland Drive, et qu’à l’évidence le film dénonce. La parfaite complicité amoureuse « éternelle et sans divorce » que vivent Betty et Rita s’avère finalement n’être que la réécriture onirique d’une brève aventure – entre Diane et Camilla – qui au contraire fut asymétrique et éphémère, dénuée de tendresse et de complicité, parasitée et détruite par la rivalité et la jalousie. Camilla a quitté Diane pour Adam et lui a infligé plusieurs humiliations, elle a piqué son rôle et brisé ses rêves, Diane s’est vengée en la faisant assassiner, et le mérite de Lynch est justement de ne pas laisser impensées l’évidence et la naturalité de cette énième histoire de femmes qui s’entretuent à cause des hommes. Il en exhibe même le caractère contingent, anormal et révoltant (en donnant à voir, sous la forme d’un rêve, son alternative : une relation vraiment complice, amicale et amoureuse) et il en dénonce la construction sociale – car c’est bien la domination masculine qui est désignée sans cesse comme la cause de la rivalité de deux femmes au départ amies et amantes, de leur séparation et de leur enfermement dans une spirale de violence, et c’est bien Hollywood qui apparaît comme le vecteur de cette domination.
Et c’est bien tout cela que vient renverser Céline et Julie : à l’opposé de la violence sororicide qui détruit les deux héroïnes de Lynch, le film de Berto, Rivette & Co donne à voir la complicité à toute épreuve de deux femmes réelles, de chair et d’os, qui s’inventent une relation singulière et en devenir, indécidablement amicale ou amoureuse, tout à la fois sensuelle et platonique, à l’écart des convenances, des codes sociaux et de toute nomenclature fixée une fois pour toutes – moyennant quoi, lorsqu’il lui faut présenter ou situer Julie, Céline s’en sort par un nom différent à chaque fois : « ma sœur », « ma cousine », « une riche américaine qui dit que j’ai kek’chose et qui veut devenir mon pyg-ma-yon ».
Et c’est à l’inverse dans le monde imaginaire, celui du « cinoche » qu’elles se font avec leur bonbon vert, que règnent sans partage la domination masculine et la violence sororicide : l’intrigue qui, sous les yeux éberlués de Céline et Julie, prend forme et s’élucide peu à peu dans la maison poussiéreuse du 7 bis rue du Nadir aux Pommes reproduit, sous sa forme la plus radicale et épurée, l’équation que Delphine Seyrig énonce et dénonce dans Sois belle et tais-toi – puisque deux femmes (Camille et Sophie) se disputent l’amour d’un même homme (Olivier, qu’elles voient comme « le meilleur parti de toute la Nouvelle Angleterre ») et sont poussées par cette rivalité aux pires extrémités, y compris l’empoisonnement à petit feu du troisième personnage féminin de la maisonnée (Madlyn, la petite fille malade dont elles sont censées s’occuper). Tout cela sous l’œil sévère mais impuissant d’un quatrième et dernier personnage féminin : la gouvernante alcoolique, Miss Angèle. Le monde du spectacle est en somme mis en cause de manière encore plus radicale que chez Lynch, puisque ce ne sont pas seulement ses coulisses qui sont dénoncées mais le contenu même des œuvres : bourgeoises, chiantes, morbides, elles propagent de surcroît des modèles de relations hommes-femmes – et entre femmes – particulièrement aliénants.
À cet univers sinistre et oppressant s’oppose donc la complicité fantastique qui se noue entre Céline et Julie, indissociablement dans la vraie vie et devant l’écran, sous bonbon vert ou dans la maison hantée, et qui les amène chacune, dans la vraie vie justement, à se libérer de toute tutelle masculine : Céline, déguisée en Julie, en ridiculisant le fiancé Guilou (avec cet adieu d’anthologie : « Et maintenant cher ami, allez donc vous branler dans les roses ! »), et Julie, déguisée en Céline, en sabotant son numéro de magie et en envoyant balader l’impresario – qualifié au passage de « maquereau cosmique ». À cet égard aussi Céline et Julie est un Mulholland Drive inversé, puisque dans le film de Lynch, c’est en rêve et en rêve seulement qu’une complicité est possible entre femmes et que des hommes (Adam Kesher, Bob Brooker, Wally Brown, Woody Katz) peuvent être ridiculisés et abandonnés.
« maquereaux cosmiques »
Si Céline et Julie rejoue ou anticipe Mulholland Drive en le renversant, c’est enfin par son ambiance et son dénouement. L’inquiétante étrangeté des visions sous bonbon vert est sans cesse désamorcée par les commentaires loufoques des deux rêveuses/spectatrices (« Ils sont pas marrants ! », « Mais qu’est-ce qu’elles veulent ces bonnes femmes ? », « Ouh là là ça barde ! », « Oh le coquin ! », « La salope ! »), par leurs fous-rires ou leurs bâillements d’ennui, par leurs pauses cigarette et leurs imitations bouffonnes mais aussi par une joyeuse vadrouille hors spectacle et un léger mais continuel dérèglement de tous les sens et de tous les sons – chez Céline surtout, dont la drôle de langue popeyesque (« Julie, j’vais pâmer », « J’crois que j’vais tomber dans la pomme », « J’étais toute traumate ») et désaccordée (« Ils en parlent dans les journals », « Elle a un hôtel particulière », « avec un maîtresse d’hôtel ») est une vivante tuerie du langage ampoulé de Sophie, Camille et Olivier.
L’inquiétante étrangeté est enfin conjurée par l’intrusion sauvage des deux lascardes sur « le lieu du drame », le joyeux bordel qu’elles y mettent et le dénouement alternatif en forme de happy end qu’elles parviennent à inventer – à l’exact opposé du climat oppressant et du suicide final vers lequel tout converge dans le film de Lynch. Entrées par effraction dans la maison hantée, Céline et Julie réinvestissent à deux le personnage d’Angèle, cet empowerment sort la nurse de son impuissance, il lui permet de tirer la petite Madlyn des griffes de ses trois assassins – et l’histoire s’achève, pour Madlyn, Céline et Julie, par une paradisiaque balade en bateau sur l’eau paisible de la Marne.
Tout cela donne bel et bien à Céline et Julie « une gaité et une légèreté inégalables », pour reprendre les mots de Gilles Deleuze, qui a raison de dire qu’il s’agit d’« un des plus grands films comiques français » [11] mais n’a pas raison de ne pas dire aussi qu’il s’agit d’un des plus grands films féministes. Car c’est bel et bien une singularité politique autant qu’esthétique qui distingue le film de Berto, Rivette & Co, y compris de son remake lynchien : là où Diane et Camilla demeurent les victimes d’un système, Céline et Julie sont les actrices d’une lutte victorieuse. Pour le dire autrement : Diane est une Céline qui n’a pas eu la chance de trouver sa Julie, une « cinéfille » solitaire qui a affronté seule le mur d’images aliénantes et oppressantes produit par le cinéma, le théâtre ou les livres, et qui s’est ainsi laissée embarquer dans des normes, des idéaux et donc des attitudes, des réactions et finalement un « destin de femme » écrits d’avance.
Ou encore, réciproquement : Céline est une Diane qui, sortie une première fois amochée d’une fiction qu’elle avait eu la mauvaise idée de visiter seule, a pu se soigner auprès de Julie et nouer des alliances entre dominées, avec Julie d’abord (comme copine et co-spectatrice) puis (sous la modalité de l’identification) avec les personnages féminins de la fiction – et plus précisément avec les plus dominés d’entre eux : la domestique alcoolique et l’enfant malade. Ces alliances lui ont permis d’inventer une autre posture pour elle comme spectatrice et un autre dénouement pour les personnages comme alter egos – autrement dit : de devenir, à partir de son expérience de spectatrice frustrée, actrice et productrice d’un imaginaire propre.
En somme, là où le film de Lynch donne à voir, comprendre et sentir l’oppression des femmes par le cinéma, celui de Berto, Rivette & Co donne à voir, sentir et comprendre la capacité de résistance des femmes face à cette oppression, et leur capacité de réappropriation des images. Là où Lynch nous montre une subjectivité (celle de Diane) totalement façonnée et étouffée par un imaginaire cinéphilique aliénant, Berto, Rivette & Co nous montrent deux subjectivités émancipées, immergées dans un spectacle aliénant et étouffant mais capables de distance, de méta-discours, d’ironie – et finalement du refus des dénouements écrits d’avance, aussi bien ceux de la fiction (la mort lente de la petite Madlyn) que ceux de la vie réelle (pour Julie le mariage avec un fiancé d’enfance, pour Céline une carrière internationale cornaquée par un maquereau cosmique).
Là où Lynch nous montre comment le spectacle peut mener une femme en bateau, ou plutôt jusqu’où ledit bateau peut mener ladite femme, jusqu’à quel niveau d’illusions et de désillusions, d’aliénation et de mutilation de l’existence, et jusqu’à quelles extrémités (un meurtre, un suicide), Céline et Julie nous montrent qu’on n’est pas obligé de se laisser embarquer. Elles nous montrent plus exactement que même embarqué, on peut se réapproprier le spectacle et apprendre à soi-même mener sa barque. Mais pour cela, justement, il ne faut pas rester seul : de même qu’il faut dans la fiction passer d’une seule à deux Miss Angèle pour que la nurse effectue pleinement sa puissance d’ange gardien de la petite Madlyn, il faut dans la réalité, pour ne plus se laisser mener mais simplement, tranquillement, librement aller en bateau, être ni Julie toute seule ni Céline toute seule, mais Céline et Julie.
« œil de Lynx et tête de bois »
C’est une affaire entendue : comme les morts gouvernent les vivants autant que les vivants gouvernent les morts, la réalité imite la fiction autant que celle-ci imite le réel. Pour le meilleur comme pour le pire, les visions de l’art structurent notre vision du réel, et les personnages fictifs façonnent de mille manières nos personnalités, par des chemins détournés que les philosophes appellent mimesis ou catharsis et que nous nommons aussi identification. Si par exemple chez Lynch les fictions de Diane endormie s’inspirent de sa vraie vie, cette vie a été elle-même conditionnée dès l’origine par d’autres fictions qui ont construit son Idéal du moi : celles du cinéma hollywoodien – et notamment de Sunset Boulevard, La Party, Le Parrain. La balade de Céline et Julie nous donne à voir elle aussi cette influence du spectacle sur la vie, mais sous un jour moins funeste, en nous montrant deux héroïnes animées par une profonde mythomanie – qui a ceci d’intéressant qu’elle n’est pas dépréciée. Il s’agit plutôt d’une faculté active d’oubli du réel et d’invention de nouvelles possibilités de vie, qui se nourrit des images de la fiction mais aussi d’un travail de réappropriation, et qui permet à Céline et Julie non seulement de se défouler, d’oublier un quotidien frustrant, mais aussi de réinvestir dans la vie réelle les films qu’elles se font, et d’entrer en lutte.
Céline surtout nous est présentée d’emblée comme une grande mythomane. Lorsqu’elle arrive amochée chez Julie, c’est par un récit aussi approximatif qu’abracadabrant qu’elle rationalise la situation – alors que toutes les hypothèses réalistes les plus sordides demeurent possibles, à commencer par le viol. Elle enchaîne aussitôt, sous la douche, par un nouveau « mytho » dont elle est l’héroïne : l’histoire loufoque d’un « Safari au Bengale, en Afrique », avec demande en mariage de « l’Empereur des Pygmées » suivie d’une séance d’acupuncture à Hong Kong :
« Tu sais j’ai vraiment failli clamser en revenant de la jongle. J’ai chopé des abîmes. J’ai perdu mes cheveux, tous mes poils, ratiboisée. J’ai eu une pétoche folle. J’étais toute traumate. Ben oui, quoi : déglinguée. On habitait Hong-Kong – c’est un rêve ce bled, je t’en causerai un jour. Là-bas y avait un Japonais qui faisait de l’acupuncture. Il me l’a faite. Et puis je suis restée un mois. Après, mes cheveux ont repoussé. Au début c’était tout rouge la couleur, et puis c’est redevenu normal. Et puis je suis rentrée. »
On la verra par la suite, dans une scène hilarante, baratiner sa bande de copains en faisant de Julie une riche américaine liée à des « grosses têtes politiques », aussi puissante que « le producteur de Marilyn », avec « masseur » et « piscine rose en forme de cœur » – un délire finalement assez voisin de celui de Mulholland Drive autour d’Hollywood et de la Mafia :
« Je vais vous raconter une histoire. Parce que moi je suis moins dans la merde que vous. Et puis vos salades, à côté, ça veut rien dire. Parce que j’ai connu une gonzesse – je suis plus avec mes petits amis là ! J’ai rencontré une bonne femme. C’est une américaine, une vraie. Une jeune femme, vachement bien. On parle d’elle dans les canards. J’habite chez elle : elle a une piscine rose. Je vais vous inviter un de ces jours, les mecs, on va se payer un petit bain chez elle. Elle veut me faire son pyg-ma-yon. Elle est bourrée de fric, on parle d’elle dans les canards, puis elle s’occupe à moi, parce qu’elle dit que j’ai kek’chose, tu vois… Et elle va peut-être me faire une grande bonne femme de la danse. Depuis deux jours je suis avec elle. Elle est rouge – rousse. Vous savez pas que je me suis fait masser ? Elle m’a massée ! Enfin, pas elle : elle a un masseur, il masse. Un mec qui a les yeux bridés… »
Nous avions en somme trouvé Céline abusée par les images – dans tous les sens du terme : dupée, malmenée, violentée – et nous la découvrons peu à peu abuseuse, en un sens cette fois-ci très joyeux. Nous la verrons enfin jouer, au sens propre, la vie de sa nouvelle copine, en allant à la place de Julie, affublée d’une perruque rousse, régler son affaire à Guilou, le fiancé d’enfance – tandis que Julie à son tour se déguisera en Céline pour aller au cabaret solder les comptes avec l’impresario paternaliste.
L’émancipation du spectateur est justement, selon les mots de Jacques Rancière, cette « capacité de voir ce qu’on voit, et de savoir quoi en penser et quoi en faire » :
« L’émancipation commence quand on remet en question l’opposition entre regarder et agir, quand on comprend que les évidences qui structurent ainsi les rapports du dire, du voir et du faire appartiennent elles-mêmes à la structure de la domination et de la sujétion. Elle commence quand on comprend que regarder est aussi une action qui confirme ou transforme cette distribution des positions. Le spectateur aussi agit, comme l’élève ou le savant. Il observe, il sélectionne, il compare, il interprète. Il lie ce qu’il voit à bien d’autres choses qu’il a vues sur d’autres scènes, en d’autres sortes de lieux. Il compose son propre poème avec les éléments du poème en face de lui. Il participe à la performance en la refaisant, en se dérobant par exemple à l’énergie vitale que celle-ci est censée transmettre pour en faire une pure image et associer cette pure image à une histoire lue ou rêvée, vécue ou inventée. » [12]
De cette émancipation, de ce travail « de spectateur distant et d’interprète actif », Céline et Julie nous propose deux formulations – l’une ésotérique, qui inscrit le film dans l’œuvre de Rivette, pleine de complots, de sortilèges et de rituels occultistes [13], l’autre plus enfantine, chantante et déconnante, probablement inventée par Juliet Berto. La première, c’est lorsqu’au début du film Julie se fait tirer les cartes par Lil, sa collègue bibliothécaire, qui lui annonce ce destin étrange : « Tu avances, mais dans l’immobilité totale. Je vois une stagnation, mais une stagnation triomphante. » La seconde, c’est lorsqu’à la fin du film, Céline et Julie ont décidé d’aller libérer la petite Madlyn et entonnent leur chant de guerre pour se donner du courage : « Un deux trois, œil de lynx et tête de bois ! ». Il n’est pas nécessaire d’expliquer en quoi l’immobilité peut renvoyer à la position du spectateur, ni en quoi l’avancée et le triomphe peuvent métaphoriser l’émancipation. Commentons plutôt la géniale devise de nos deux guerrières : elle nous dit qu’on peut d’un même mouvement s’immerger totalement dans le spectacle, absorber toutes ses images, en prendre plein les yeux, chercher à tout voir – donc se faire un œil de lynx – et garder son quant à soi, sa distance méfiante ou amusée, sa capacité de sortir à tout moment de la fascination en osant commenter, chercher « la salope » et trouver les coupables, vanner le scénario, insulter les personnages, rejouer la scène, réécrire la fin, bailler, rire ou ricaner – bref : rester une vraie tête de bois. En résumé, dans une langue moins philosophique que celle de Rancière, œil de lynx signifie : spectateur – et tête de bois : émancipé. Ou, si l’on reprend ses définitions : l’œil de lynx est la « capacité de voir ce qu’on voit » et la tête de bois celle de « savoir ce qu’on en pense et ce qu’on en fait ».
Cela dit, ce n’est pas seulement Rancière qui éclaire Céline et Julie mais aussi et surtout l’inverse : à ses analyses, certes importantes mais toujours centrées sur « le spectateur », c’est-à-dire sur un rapport au spectacle qui se conjugue au masculin singulier, Céline et Julie apportent un utile complément. Elles nous invitent à politiser plus encore la question du spectacle en passant au féminin et au pluriel, et en envisageant ainsi deux problématiques absentes chez le philosophe. D’une part la question du genre, j’entends par là cette violence particulière que renferme, pour une spectatrice femme, « la fable cinématographique », qui s’organise fondamentalement sans les femmes ou contre les femmes. D’autre part la dimension collective de la pratique de spectatrice, plus essentielle encore que pour le spectateur, dans la mesure où l’existence de spectatrices émancipées plutôt qu’écrasées par la toute-puissance aliénante du spectacle requiert, pour elles, une capacité de résistance, d’irrévérence, de réappropriation – et donc un empowerment que seule peut produire l’union de plusieurs spectatrices qui, comme Céline et Julie, s’acoquinent, s’aiment et se parlent. Avant le film, après, et pourquoi pas pendant.
« dans la pistoche »
Bien d’autres lectures demeurent évidemment possibles, notamment une lecture psychédélique, prenant au sérieux la puissance hallucinatoire du petit bonbon vert, et une lecture psychanalytique, attentive à une visite de Julie à son ancienne nourrice – au cours de laquelle nous apprenons que c’est un de ses souvenirs d’enfance qui sert de matrice au film qu’elle se fait avec sa copine Céline [14]. Mais ces lectures, comme toutes les autres possibles, manquent l’essentiel si elles ne prennent pas en compte, elles aussi, les lignes de fuite créatrices que permet l’indéfectible alliance de Céline et Julie. Les psychanalyses sauvages et les trips entre copines sont des expériences singulières, aussi radicalement différentes des psychanalyses et des trips en solo (seule face à son psy, seule avec sa came) que la cinéphilie à deux l’est de la cinéphilie solitaire (seule face au film).
On pourra objecter enfin que tout cela n’est qu’un rêve – puisque la toute dernière séquence du film nous montre Céline assoupie dans le square où toute l’histoire a commencé, apercevant à son réveil Julie en train de passer. Mais justement, à la différence de Mulholland Drive, à la fin duquel Diane réveillée reste prostrée chez elle, emmurée dans une irrémédiable solitude, le rêve n’est pas simplement opposé à la dure réalité : forte du monde possible qu’elle a fictionné, Céline adresse à Julie un détonnant « Hep ! Hep ! Vous oubliez votre écureuil ! », et s’élance à ses trousses afin de donner à son rêve les suites réelles qu’il autorise. Dans le rêve comme dans toutes les fictions, Céline sait ce qu’elle a vu, ce qu’elle en pense et quoi en faire.
Le film dès lors peut devenir une matrice théorique, ou plus simplement un cri de ralliement. On pourra parler d’abord de Céline & Julie Movies, pour désigner un sous-genre à l’intérieur du genre homologué – et répertorié sur wikipedia – des Female Buddy Films : le sous-genre des films où deux femmes se rencontrent, s’entendent et premièrement s’amusent et déconnent, deuxièmement se battent contre une puissance oppressive, troisièmement ne sont pas punies pour leur audace, leur irrévérence et leur rigolade. Le film de Lynch par conséquent n’est pas un Céline & Julie Movie, mais le rêve de Diane en est un.
C’est aussi une nouvelle forme de cinéphilie qui est inventée puisqu’avant de passer à l’action, Céline et Julie passent le plus clair de leur temps à être les spectatrices d’une autre histoire : celle qui se répète sans fin au 7 bis rue du Nadir aux Pommes. Et c’est par là d’ailleurs que le film peut toucher des hommes et pas seulement des femmes. D’abord parce qu’il rend service aux hommes aussi en cartographiant – et ridiculisant férocement – quelques-unes des figures les plus pourries de la masculinité (le fiancé fleur bleue Guilou ou l’impresario paternaliste avec son gros cigare, sans oublier Olivier le grand bourgeois ténébreux veuf et inconsolé), en même temps que les figures correspondantes de la féminité (la maman et la putain que sont censées devenir, respectivement, Julie et Céline – mais aussi la grande dame Sophie et Camille la femme-enfant) [15]. Ensuite parce que le film laisse entrevoir la possibilité d’une masculinité moins bête et moins méchante : celle justement qui s’inspirerait de la dérive de Céline et Julie. C’est le cas notamment dans l’importante séquence où Céline baratine ses collègues du cabaret montmartrois. Parmi les trois hommes qui l’écoutent déblatérer sur sa nouvelle copine américaine, deux réagissent vraiment : le pianiste, qui tient parfaitement son rôle d’homme en tirant la tronche et en refusant d’être dupe (et finit par se faire traiter de « pauvre cul »), mais aussi un sympathique acolyte à tignasse rousse qui, bon public, suit Céline dans son délire – en acceptant avec enthousiasme l’invitation dans la « pistoche rose en forme de cœur », en apportant au récit ses propres grains de sel mythomaniaques, et en inventant par exemple un improbable « producteur de Marilyn ». Telle est sans doute l’invitation qui est faite aussi bien aux cinéfils qu’aux cinéfilles : devenir ce bon public, qui de bon cœur joue le jeu de l’affabulation, car tous et toutes nous avons besoin – même si ce n’est pas exactement le même besoin – de prendre le large, de nous éloigner de la liturgie cinéphilique française, de nous laisser entraîner dans ces histoires à la Céline et Julie, de nous inspirer de leurs divagations – bref, auraient dit Gilles Deleuze et Félix Guattari [16] : d’entrer, femmes et hommes, spectatrices et spectateurs, dans des devenirs-Céline-et-Julie.
notes
[1] Voir le chapitre 5 : « Il ne m’a pas trouvée bonne ».
[2] Betty est d’abord choquée et décontenancée par les gestes déplacés du vieil acteur, mais très vite elle entre dans son jeu au-delà de tout ce qu’il espère, et la scène, torride, s’achève sur un long et profond baiser. Si Diane a eu besoin de rêver une telle séquence, en mentionnant bien qu’auparavant une « brunette » a elle aussi joué la scène « collé-serré », cela suggère que dans la réalité, Diane n’a pas accepté de coucher alors que Camilla l’a fait – ou en tout cas que Diane a soupçonné Camilla de l’avoir fait. La séquence rêvée est alors la seconde chance que se donne Diane : sous les traits de Betty, elle devient plus avisée, pragmatique voire cynique. Woody Katz l’informant qu’une brunette a joué collé-serré avec lui, elle tire profit de l’information et se résout à accepter la règle du jeu : si tu veux le rôle, il faut être « une bombe ».
[3] Voir Jean-Pierre Vernant, La mort dans les yeux. Figures de l’Autre en Grèce ancienne, Hachette, 1985.
[4] Un indice supplémentaire plaide en faveur de cette équation. Au moment où Betty et Rita appellent un taxi pour se rendre au Silencio, on aperçoit un instant, au premier plan, un lampadaire sur lequel est collée une affichette, où l’on devine deux mots, écrits plus gros que les autres : Silencio d’une part, et d’autre part Hell, qui signifie tout bonnement : Enfer.
[5] Haine de soi, remords, mauvaise conscience : c’est ce que vient incarner également un couple de vieillards qui apparaît trois fois. Une première fois radieux, en surimpression, à la fin de la séquence dansée qui ouvre le film, en pré-générique : ils accompagnent Diane, tout aussi radieuse, qui salue le public – on apprendra à la fin du film (dans le récit de Diane) qu’il s’agit d’un concours de danse qu’elle a remporté et qui l’a décidée à tenter sa chance à Hollywood. Les deux vieillards peuvent donc être identifiés a posteriori comme deux parents fiers de leur fille. Ils réapparaissent ensuite au début du rêve, quand Betty atterrit à Hollywood. Il n’y a alors aucun lien de parenté : les deux vieillards sont simplement deux passagers qui ont lié connaissance avec la jeune femme dans l’avion, et ils la saluent à l’aéroport en lui souhaitant bonne chance, avant de prendre leur propre taxi. Leur sourire se fige alors, un sourire excessif, forcé, qui pourrait être inquiétant mais produit plutôt un effet comique. Ils resurgissent enfin après le réveil de Diane, sous la forme d’une terrifiante hallucination : alors qu’on frappe à sa porte, Diane n’ouvre pas mais les deux vieillards, devenus minuscules, se glissent sous la porte, lui foncent dessus et la poursuivent jusqu’à son lit, où elle se suicide. Sans doute Diane comprend-elle alors que, même si elle échappe à la justice des hommes, il y aura toujours ce tribunal auquel elle ne peut échapper – quelque chose qu’une porte fermée n’arrête pas. Cette instance, symbolisée par deux vieillards miniaturisés qui peuvent se faufiler partout et nous poursuivre jusque dans nos derniers retranchements, porte un nom : conscience morale ou, pour reprendre un autre concept freudien, Surmoi. Qu’est-ce en effet que le Surmoi tel que le décrit Freud, sinon un petit papa-maman miniaturisé qui vient se loger à l’intérieur de notre psychisme ? Ces deux vieillards, qui pour Diane ont été des anges gardiens, sont devenus ses démons. Ces parents fiers au concours de danse, et confiants lorsqu’elle part tenter sa chance à Hollywood, ne peuvent plus incarner désormais que le jugement moral et la punition, en poursuivant leur fille fautive.
[6] Cette demande de pardon adressée à Betty est d’autant plus réparatrice que dans la réalité, c’est Diane qui a dû demander pardon, dans un contexte particulièrement humiliant : arrivée en retard à Mulholland Drive, à une fête où va être annoncé le mariage d’Adam et Camilla, elle est reçue par la mère du cinéaste, qui la regarde fixement sans lui dire bonjour, et lance à son intention : « Ah, enfin ! Je mourais de faim ! ».
[7] L’origine de ce nom un peu ridicule apparaît clairement dans les souvenirs de Diane à la toute fin du film : au moment où Madame Kesher, après avoir écouté Diane raconter ses échecs professionnels, lui tapote la main en guise de réconfort, un gros plan nous montre, sur la table, un grand bol rempli de noix. Le choix de la langue française demeure mystérieux, mais l’origine du nom Lenoix est tout à fait élucidée.
[8] Adam Kesher s’avère être lui aussi un perdant, et même une victime de la domination dont il est censé être le bénéficiaire : il perd la femme aimée (Camilla Rhodes) dans les pires conditions (elle est assassinée), très peu de temps après l’avoir conquise.
[9] Sur cette malédiction, voir Pacôme Thiellement, « La femme de ma mort. Opening Night de John Cassavetes », dans Cinéma Hermetica, Super 8 éditions, 2016.
[10] Réalisé par Jacques Rivette, le film est co-écrit avec Eduardo de Gregorio et les quatre actrices principales : Juliet Berto, Dominique Labourier, Bulle Ogier et Marie-France Pisier.
[11] Gilles Deleuze, Cinéma 2, Minuit, 1985, p. 19.
[12] Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, La Fabrique, 2008, p. 19.
[13] Voir Pacôme Thiellement, « Le monde imaginal ténébreux de tout ce qui cloche dans le monde », lmsi.net.
[14] Voir Faysal Riad, « Un bateau ivre », lmsi.net.
[15] Voir Pacôme Thiellement, article cité.
[16] Voir Gilles Deleuze, Félix Guattari, « Devenir femme, devenir enfant, devenir imperceptible », dans Mille Plateaux, Minuit, 1980.
crédits
isbn (lyber) 979-10-92903-05-8
© Dans nos histoires, 2019